Les afficionados du Sanglier connaissent son appétit démesuré pour les aventures insolites de la Saga de Mô, véritable épopée du bassin de Thau et de sa faune de marginaux, minuscule univers en condensé où l’Histoire s’ouvre au large et se frotte au fantastique. C’est donc sans surprise que, cette année-ci, je me suis offert, en guise de cadeau de Noël anticipé, la lecture du petit dernier en date de Michel Torres, Tabarka, quatrième épisode de la Saga, paru le 1 juin 2016 déjà, toujours chez publie.net.
Mô est donc de retour, et depuis longtemps, des expéditions mythologiques de l’épisode précédent, des expéditions dans lesquelles l’a entraîné son oncle, grand criminel nazi nostalgique de ses exploits meurtriers et en quête de ses complices morts. Remonté des profondeurs infectes de l’Étang d’encre où il a sondé, Dante moderne, l’enfer de toutes les haines, on le retrouve campé au bord de son étang à lui, celui de Thau, melting-pot des civilisations méditerranéennes, celui qui l’a vu naître et où il s’est installé bien à l’écart des gens et du monde, reclus volontaire dans la solitude de sa baraque, dans celle de ses plongées, de ses excursions en mer, et dans celle surtout, bien plus profonde encore, de ses souvenirs ressassés à l’abri des regards.
Vingt ans ont passé depuis son périple souterrain, et le lecteur le retrouve – comme si de rien n’était, comme si le passage des années ne pouvait affecter ce personnage aux dimensions légendaires – dans le décor devenu familier, au bord du canal bien connu, seul avec ses fantômes, guettant dans le noir. Et les fantômes, ils sont légion depuis le temps, ceux de ses parents, de ses camarades, de ses amours.
[Mô] n’arrive pas à réaliser la mort de son ami ; ça tombe comme des mouches autour de lui, une danse macabre. (Tabarka, chap. 29 Le phare)
Parce qu’il ne faut pas se tromper ! La vie de ce loup devenu vieux n’est pas aussi solitaire que ce que les cliches pourraient faire croire, certaines de ses rencontres ayant laissé des traces et des cicatrices. Et le silence où Mô essaie d’enfermer les échos de ce passé est d’autant plus assourdissant qu’on le devine grouillant de voix d’outre-tombe. Peu importe que ces spectres prennent, à l’occasion, la forme d’une araignée, Parque en train de tranquillement tisser ses toiles.

Parmi ces spectres-là, il y a aussi des femmes. Si Mô n’est pas à proprement parler un séducteur, un homme à femmes, cela ne veut pas dire pour autant que lui les laisse indifférentes. Et pourtant, elles sont spéciales, celles qui se laissent tenter, par nécessité plutôt que par choix, des créatures bien fragiles auxquelles Mô essaie de rendre un peu de force, un semblant de confiance. Cette fois-ci, après Malika disparue vingt ans plus tôt, il y a Liu, sirène aux yeux bridés, repêchée au large de Sète, à l’issue d’une affaire ayant mal tournée. Projetée dans les bras de Mô sans qu’on sache d’où elle vienne, c’est celui-ci qui finit par s’accrocher à elle comme à un ultime espoir d’échapper à la solitude avec son cortège de maux. Il la ramasse, butin arraché aux mains de la mafia, la dépose dans sa baraque, prend soin d’elle pendant ses crises de manque, se terre avec elle au fond de son Tabarka [1]Il faut sans doute préciser, à l’intention des non-initiés qui, comme moi, n’ont pas le privilège d’habiter les lieux, que Tabarka, c’est aujourd’hui le nom d’une sorte de parc, ancien … Continue reading d’abord, dans les anciennes salines ensuite, pour se mettre à l’abri des mauvaises surprises et des balles tirées à l’improviste. Et c’est la lente fuite de ce couple improbable, rythmée par l’eau stagnante de la lagune, qui donne à l’auteur l’occasion de longuement évoquer le littoral, sa solitude désertique aux effluves salines, ses plaies creusées par l’homme et sa voracité, et ses racines qui descendent aussi loin que l’humanité. Ce sont là sans aucun doute les meilleures pages de ce récit une fois encore riche en découvertes, d’un récit qui met en évidence la dimension mythique de cette région, une emprise à laquelle les faits et les gestes des humains n’échappent pas, du passé le plus reculé des
blocs de pierre taillée de l’antique jetée gréco-romaine, oubliés des dieux et des hommes, quais perdus, submergés, en partie enlisés, recouverts d’un fauvisme mouvant d’algues brunes, rousses et jaunes (chap. 1, Héros)
jusqu’à la modernité et la décharge près de Sète, « infection légale sur le lido, l’un des cancers du cordon littoral » (chap. 18, Sa Camargue, petite), déluge d’ordures envahies par les rats, peuple mythique avec son cortège d’épidémies et de malédictions, armée de chevaliers apocalyptiques, trait d’union entre les plaies bibliques et les légendes du folklore européen.
Le rôle de Liu ne se borne pourtant pas à cette drôle d’invitation au voyage, et elle n’est pas un bête prétexte pour laisser à l’auteur le plaisir d’emmener ses lecteurs dans une promenade vers les lieux qui lui sont chers. Elle a aussi un rôle à jouer, et celui-ci consiste non seulement à faire déclencher la vendetta finale, mais aussi à rendre à Mô une jeunesse – tout ce qu’il y a de plus provisoire – retrouvée au sein de l’eau, son élément, devenue le témoin de ses ébats et de ses batifolages avec une belle Naïade qui sait garder ses secrets – si elle en a -, qui refuse de rien dévoiler de ses antécédents et qui finit par disparaître (à moins de se dissoudre) dans la nature sans laisser de traces. Une disparition qui laisse le lecteur en proie à des visions dantesques à propos du sort que Liu a pu subir, l’imagination exacerbée par la violence insoutenablement explicite des assassinats auxquels Michel Torres contraint ses lecteurs à assister. L’absence de toute indication positive de ce qui a bien pu arriver à la jeune femme – une fuite ? un crime ? – est une belle application poussée à l’extrême du précepte que Barbey d’Aurevilly a placé dans la bouche d’un de ses narrateurs, à savoir que
l’enfer, vu par un soupirail, devrait être plus effrayant que si, d’un seul et planant regard, on pouvait l’embrasser tout entier. (Le dessous de cartes d’une partie de whist)
Michel Torres excelle, on en a l’habitude depuis le premier épisode de la Saga, quand il évoque le passé de sa région, la flore et la faune de son littoral à la configuration bien particulière, où les vestiges du passé se cachent à fleur d’eau et où les fantômes sortent de leur domaine pour se promener en plein jour. La richesse de ce que l’on découvre, en compagnie de Mô, laisse le lecteur sans voix, en train de se rêver dans un monde déchiré entre la persistance des origines et le tenace refus de se dissoudre dans l’acide d’une modernité qu’on voit pourtant éclore un peu partout.
Malgré tout le bien que je peux dire de ce roman, il me semble pourtant que le quatrième épisode, s’il répond à un grand nombre des attentes des lecteurs, est moins bien construit que les épisodes précédents, ce qui se traduit surtout par une conclusion bien trop linéaire qui coupe court à la tension construite pendant de longs chapitres. L’auteur a habitué ses lecteurs aux dénouements tragiques, aux déchaînements d’une cruauté sans bornes, à l’impossibilité du bonheur aussi, surtout quand il s’agit de son protagoniste. Quand celui-ci vit donc, l’espace de quelques chapitres, une sorte de bonheur en comprimé, la certitude de voir celui-ci se briser se double de l’angoisse des tourmentes à venir, et on craint le pire pour celle qui a eu le malheur de se frotter, bon gré mal gré, de trop près au grand solitaire, promise sans doute à une mort atroce. Si le bonheur s’efface effectivement avec la disparition de Liu, les craintes aussi délicieuses que terribles sont trompées, et tout se hâte vers une fin qui surprend tout le monde comme si de rien n’était, et le massacre final se déroule, malgré les cadavres déchiquetés, de façon presque clinique. Le showdown n’aura tout simplement pas lieu, et la catharsis a été décommandée. Un peu comme si le grand méchant loup avait rendu son dernier souffle tranquillement au fond du bois, à l’abri des regards, loin des yeux, loin du cœur. On se demande un peu pourquoi tant d’énergie a été dépensée, pourquoi tant de violence a été imaginée, pour laisser finir tout ça comme si le héros découvrait soudain qu’il allait rater un rencard et qu’il fallait donc se grouiller pour se débarrasser de cette affaire inopportune.
On peut lire, sur le site de publie.net, que Tabarka a été « écrit avant les autres tomes », et cela explique peut-être ces quelques faiblesses dans la composition du récit. Ce qui est par contre certain, c’est que Michel Torres a donné avec ce texte un morceau de bravoure, un diamant – imparfaitement taillé peut-être, mais diamant toujours – un échantillon de ce qu’allait devenir la Saga de Mô, récit aux dimensions mythiques où le scintillement de la Méditerranée illumine jusqu’au noir des âmes en peine, et ou le moindre des gestes peut toucher au sublime en devenant rite, geste par lequel le mythe se construit au quotidien …
« quand on a tout perdu restent les rites” Tabarka, t. 4 de La Saga de Mô, par Michel Torres »
Michel Torres
Tabarka
publie net
ISBN : 9782371771505
Références
| ↑1 | Il faut sans doute préciser, à l’intention des non-initiés qui, comme moi, n’ont pas le privilège d’habiter les lieux, que Tabarka, c’est aujourd’hui le nom d’une sorte de parc, ancien terrain vague, coincé entre les lotissements de Marseillan et l’Étang, adjacent au port qui en tire son nom – à moins que ce ne soit l’inverse. |
|---|

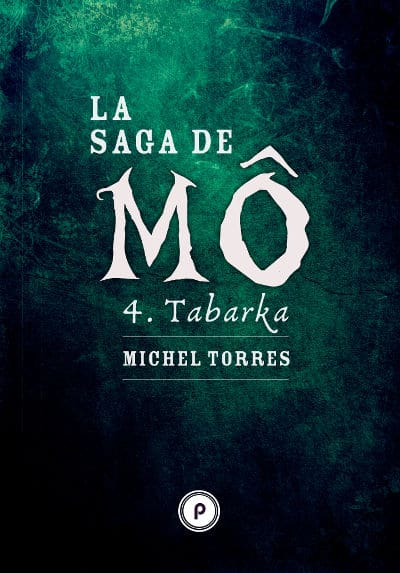
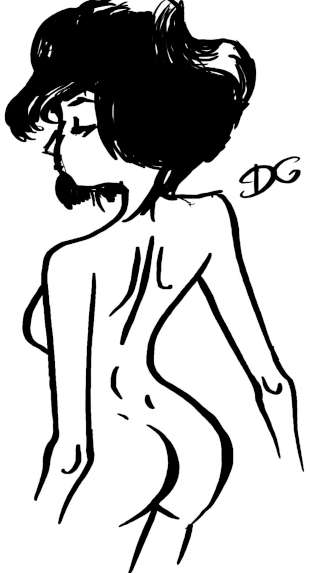
Commentaires
Une réponse à “Michel Torres, Tabarka. La Saga de Mô, t. 4”
Très juste critique taillée dans le bois même de la Saga. Merci. Je craignais d’avoir perdu le Sanglier et je suis ravi de l’avoir retrouvé.