On a pu dire, à propos de À volonté, court roman de Léa Rivière, que c’était « un livre sur la sexualité des bipolaires » [1]Marie Minelli dans un article paru le 2 novembre 2014 sur Le Plus. N’étant pas médecin et encore moins psychiatre, je vais éviter de donner un diagnostic, mais il me semble qu’il faut aborder ce texte par un côté différent, à savoir celui de la démesure boulimique, de la pulsion qui pousse à vouloir s’approprier la vie des autres, se glisser dans la peau de n’importe quel personnage qu’on croise, à l’instar de ces êtres mystiques qui puisent leur immortalité dans la force vitale d’autrui. Sauf que l’issue de ce texte-ci donne sur d’autres univers.
L’avant-propos du roman contient un passage qui, en décrivant les symptômes de la maladie dont souffre la narratrice, est la définition même du vampirisme :
« Une faim de vivre, une soif de tout, une envie de dévorer la vie et tout ce qu’elle peut apporter. » [2]Léa Rivière, À volonté, Paris 2014, p. 7
Oui, effectivement, une soif de tout… Une soif qui n’est pourtant pas assouvie par le sang, ce serait trop facile, non ? Mais de quoi peut bien se nourrir une personne qui lance à la figure de ses lecteurs qu’elle a « faim de vie, […] faim des hommes [qu’elle] rencontre » [3]p. 8, sans aller jusqu’à commettre des meurtres ? Parce que les fantômes qui se changent en brouillard ou en chauve-souris et qu’on n’atteint pas avec les moyens de l’état de droit, c’est du domaine des contes de fées et des cauchemars balkaniques. La réponse s’impose : elle doit se borner à se nourrir de fantasmes. Dont certains se réalisent, avec des gens croisés à l’improviste, et dont la protagoniste est tombée amoureuse au moment de les avoir croisés, dans une démesure qui va de pair avec celle de sa faim. Parce que l’amour s’apparente à l’envie de s’ingérer l’autre, de le priver de son existence indépendante pour le faire vivre au fond de ses propres entrailles. Le souvenir de faits divers inquiétants surgit à la lecture de ces lignes, comme celui du « cannibale de Rotenburg » en Allemagne qui a défrayé les chroniques il y a à peine cinq ans, parce qu’il a précisément voulu sortir des limites du fantasme…
Justine ne va pas aussi loin et elle doit trop souvent rester sur sa faim, comme dans l’épisode où son amant (et futur mari) lui pose un lapin en annulant, à la dernière minute, un rendez-vous. La voilà « épilée, habillée, maquillée, coiffée, apprêtée, excitée » [4]p. 84, mais surtout – frustrée. S’ensuit un entracte avec comme protagonistes quelques tasses de thé et plusieurs « lots de biscuits type Prince de Lu, version low cost » [5]p. 85, entracte tellement écœurant qu’on a mal au ventre rien qu’en lisant. Mais Justine ne fait que payer le prix de sa retenue, de se résistance en fin de compte. Et son corps et sa psyché réagissent, sa peau se couvre d’eczémas qu’elle gratte jusqu’au sang, sa faim s’exacerbe, le désordre s’installe dans sa vie, un désordre qui se manifeste jusque dans l’agencement des chapitres de son journal (que le roman est censé reproduire) et qui l’amène à fuir sa famille, à négliger ses filles, à passer entre des mains toujours plus crades.
Le lecteur est mal à l’aise dans son rôle de témoin réduit au silence, témoin impuissant qui assiste au ballet funèbre qui se déroule dans un décor des plus bourgeois. Comment, de l’extérieur, deviner les abîmes qui se creusent derrière la façade de cette famille dont les apparences n’ont rien qui puisse choquer ? Et pourtant, ils sont bien là, ces abîmes, à l’abri des regards qui n’interrogent pas, et on a peur à force de regarder Justine les frôler de trop près. On finit par attendre comme une évidence l’instant où le vertige s’empare de tout ce petit monde, et on n’est finalement pas surpris de tout voir sombrer.
La voix de Justine, on s’en rend compte sur le tard, est donc une de celles qui se prolongent par-delà la tombe, une de plus qui fait retentir la littérature française habituée depuis longtemps à entendre les témoignages de ceux qui sont morts. On sort de ce texte comme d’un cauchemar, mais on aimerait savoir si l’horreur est bien restée de l’autre côté des portes dont parlait Virgile ou si elle a pu sournoisement se glisser dans la vie en empruntant les portes – de corne…
Je me suis borné à interroger un seul aspect de ce texte, assez court par le nombre de ses pages, mais plein de pistes qui guident le lecteur loin de son petit coin confortable. À volonté, cela s’applique aussi au nombre de questions qu’on pourrait adresser au roman de Léa Rivière, comme par exemple celle de savoir qui, au juste, est Soren, cet ami intime dont la mort a laissé une lacune qu’il fallait combler, lacune où s’est installé AL, ce condensé ectoplasmatique du désordre dont est atteinte la protagoniste. Quel rôle est celui de l’Art dans un roman dont la protagoniste est, après tout, une pianiste douée qui a dû renoncer à cette vocation-là à cause des médicaments qui font trembler ses mains. La créativité qui n’arrive pas à s’exprimer, qui reste enfermée dans un corps impuissant, là aussi il y a une faim privée de nourriture. Quoi qu’il en soit des question qu’il faut poser et des réponses qu’il reste à trouver, je salue la perspicacité de celui qui, chez Blanche, a su débusquer une auteure dont on n’aura pas fini de parler.
PS – Vanda Spengler mérite une mention spéciale pour la photo de couverture, photo qui non seulement tranche de façon radicale avec les couvertures souvent assez quelconque voire vulgaires qu’on a pris l’habitude de voir s’afficher sur les titres de chez Blanche (un beau spécimen est celui qui défigure le texte que j’ai reçu en même temps que celui de Léa Rivière, Club Privé), mais qui illustre si bien le propos de ce petit texte aux interrogations multiples.
Léa Rivière
À volonté
Éditions Blanche
ISBN : 978–2846283540


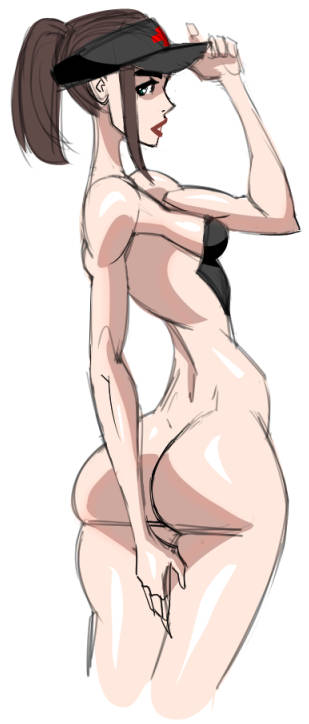
Commentaires
Une réponse à “Léa Rivière, À volonté”
Bonsoir Thomas,
Je partage votre point de vue sur la couverture : effectivement elle sort de l’ordinaire. J’aime bien ;-) !