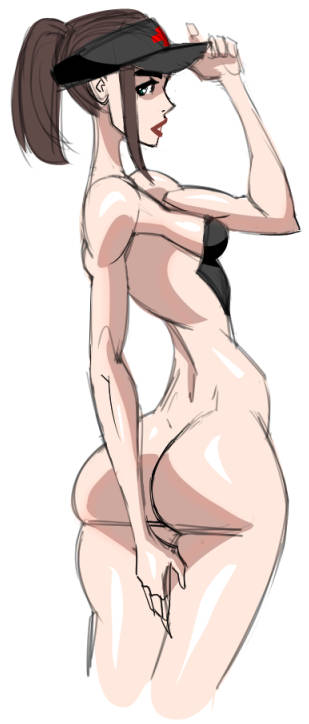Il y a une chose que je peux affirmer avec certitude : les voies de la littérature sont parfois tout à fait incompréhensibles. Vous vous demandez ce qui m’amène à emprunter cette citation à l’infatigable voyageur et zélé missionnaire que fut Saint Paul ? Et bien, c’est une découverte des plus improbables, faite au gré de mes divagations littéraires à travers les étagères virtuelles où s’étalent les nouveautés dans un effort d’attirer l’attention du flâneur qui passe sans penser à mal. Comme vous devez le savoir, c’est effectivement une de mes occupations préférées, un plaisir pas toujours si innocent que ça auquel je m’abandonne dès que le besoin de prendre un peu d’air se fait sentir et que je ressens la nécessité de croquer de nouvelles chairs. Me voici donc embarqué sur la page des nouveautés de chez 7switch quand un titre, publié aux Éditions XYZ, attire mon attention : Monogamies ou Comment une chanteuse country a fucké ma vie sexuelle, le tout affublé du nom d’une parfaite inconnue, Jolène Ruest. Et ben, dis donc, voici un titre qui a le mérite de l’insolite, tant par l’évocation de la chanteuse qui se voit attribuer le rôle du grand méchant loup que par l’anglicisme qui s’affiche avec fierté et insouciance. Cela promet ! Lancer un moteur de recherche et me rendre sur le site de l’éditeur (québécois, ce qui explique sans doute la présence de cet emprunt décomplexé à la langue de Shakespeare) fut l’affaire de quelques secondes, et j’ai vu arriver un SP (vive le numérique !) deux jours plus tard dans ma boîte mail. Depuis, quel plaisir que de suivre les aventures de cette jeune Montréalaise, Jolène, qui partage avec l’autrice non seulement le prénom, mais aussi l’âge, l’amour immodéré de la musique, et peut-être bien des choses encore, mais comme je ne peux rien affirmer avec certitude là-dessus, je vais profiter de la distance qu’on a l’habitude de postuler entre autrice et narratrice pour m’empêcher – à regret, je vous assure ! – de spéculer sur ce que peut être la vie de cette Jolène bien réelle qui existe quelque part de l’autre côté du grand étang. Je me borne juste à vous donner sa photo où elle expose non seulement un sourire des plus ravissants, mais encore un sens esthétique qui va jusqu’à trouver un accord entre la coloration de ses cheveux et son foulard…
Au lieu de cela, parlons donc de Monogamies, un titre qui donne lieu à des interrogations, rien que par le choix du pluriel qui semble remettre en question le sujet même qu’il se propose d’interroger. Un regard inquisiteur sur l’intrigue – si on peut mettre ce terme sur le récit des batifolages des trois protagonistes, Jolène, Bear et Pouliche – s’impose, et on se rend vite compte que les personnages de ce roman sont aux prises avec l’idée même de ce type de relation dont ils peinent à franchir la première étape consistant à se trouver un partenaire. Et pourtant, ce n’est pas faute d’essayer ! Jolène hante les bars et les salles de concert, toujours prête à se lancer dans une rencontre, un peu à la façon des body-surf qu’elle apprécie tellement, Bear se connecte de façon compulsive sur un site de rencontre gay sans pour autant décrocher le numéro gagnant, et Pouliche se languit après son amant, éternel absent grâce à son travail à l’autre côté du pays (et je vous rappelle qu’on parle du Canada, les distances étant donc de vraies obstacles pour les rencontres à l’improviste), une absence qui préfigure en quelque sorte la fin de leur relation.
Il s’y passe donc des choses, dans ce texte, bien évidemment, mais on a l’impression de voir les personnages tourner en rond, impression renforcée par le caractère répétitif de certains éléments, comme par exemple l’énumération, en début d’épisode, des composants de ses petits-déjeuners – avec parfois quelques légères variations bien en dessous du seuil de visibilité. La narratrice prend d’ailleurs soin de numéroter ses gueules de bois qui précèdent les petits-déjeuners en question, de façon à ce que ceux-ci puissent servir de repère dans le texte au même titre que les intitulés des chapitres.
Des intitulés qu’il convient, d’ailleurs, de signaler aux internautes : Testostérone, Phényléthylamine, Lulibérine, Dopamine, Ocytocine, Prolactine. Du latin, tout ça ? Plutôt du grec, sans doute, mais ce qu’il convient de savoir, c’est que ce charabia désigne des hormones toutes liées à la reproduction, que ce soit la naissance du sentiment amoureux, le désir de proximité, voire la lactation (prolactine), réaction biologique qui accompagne l’enfantement et couronne – clôt ? – le processus déclenché par ce raz de marée bio-chimique que subit le cerveau de la pauvre victime. Je laisse à d’autres le soin de chercher les correlations entre l’hormone épithète et le contenu des chapitres respectifs, je me borne à indiquer que l’ordre présente un certain decrescendo, dans la mesure où les quatre premières seraient surtout liées à l’activité sexuelle (le testostérone augmenterait, par exemple, la circulation du sang dans les organes sexuels, ce qui rend plus réceptif au plaisir), tandis que le couple qui clôt l’énumération aurait des effets moins orageux, à savoir de prédisposer à la tendresse et de déclencher la lactation.
Je ne pense pas qu’on puisse en déduire la volonté de l’autrice de donner au texte un caractère érudit, voire de présenter une certaine théorie de l’amour, mais il convient de noter que Jolène Ruest place la question des relations humaines, en grande partie régies par la sexualité et le désir, dans un contexte biologique, naturel, qui évite de tomber dans le piège tendu par les partisans de l’amour romantique qui serait, en fin de compte, rien qu’un outil rendu efficace et presque irrésistible par un processus évolutionnaire afin de garantir la continuité de l’espèce. Mais comme on ne peut échapper à sa condition, on subit de plein fouet l’assaut de son héritage biologique…
Mais je sens que je divague et que de telles réflexions pourraient sans doute induire le lecteur peu soupçonneux à passer à côté de ce que Monogamies est avant tout, à savoir une tranche de vie (terme qu’il faudrait d’ailleurs, à l’instar du titre du roman, mettre au pluriel) tirée du quotidien de trois jeunes gens qui se dévoilent peu à peu, avec leurs aspirations, leurs échecs et leur amitié mise parfois à rude épreuve, des pièces d’un puzzle dont Jolène Ruest sait rendre le caractère profondément humain avec une attention aux détails qui la confirme comme fine observatrice de la vie quotidienne, capable de donner une signification aux actes les plus infimes, comme ce geste de Bear, par exemple, qui ramasse des chaussures pour permettre à Jolène de récupérer celles qu’elle a laissées chez son one-night-stand, fuyant une rencontre bien embarrassante, dans une de ses expéditions nocturnes, une quête pour retrouver un potentiel Mister Right entraperçu, ou ces petites discussions échevelées à propos de rien du tout qui prennent toute leur dimension en tournant autour d’un néant qu’elles arrivent à tenir éloigné grâce à la chaleur humaine qui en émane et se dégage du texte pour irradier jusque dans les neurones du lecteur qui s’en délecte sans d’abord rien capter. Inutile d’ailleurs de vouloir vous donner un échantillon, tellement ces conversations débordent de détails qu’il faut savoir placer dans le contexte. Ce qui est sans doute un des atouts de ce texte qu’on lit et qu’on relit, avec toujours plus de plaisir, jusqu’à devenir complice des protagonistes qu’on voit beurrer leurs tartines, qu’on entend évoquer leurs rencontres et dont on reçoit les confidences comme si celles-ci nous étaient personnellement adressées. Malgré cet avertissement, je ne résiste pas à la tentation de vous donner un aperçu avec tout ce qu’il contient d’exotique (tout relatif, rappelez-vous que je parle ici avec une perspective européenne), de farfelu et – encore une fois – d’humain. Une humanité qui n’a pas besoin de grands gestes pour s’affirmer, qui est juste là, tout près, et qui s’exprime dans un souci, dans un regard, un geste irréfléchi :
« — Check ça, c’est du vrai bacon ! Pas comme ton affaire de l’autre jour, se vante-t-il [i.e. Bear] en saisissant une tranche comme une médaille olympique.
Esti de Bear ! si fier qu’il s’en brûle. Il laisse tomber la tranche dans la poêle avant de rincer sa brûlure à l’eau froide.
— J’pensais à ton [i.e. celui de Jolène] projet, poursuit Bear. J’me suis dit : pourquoi a va pas dans un bar échangiste ? Tu trouveras du monde ouvert, tester des affaires. Tu veux encore du lait dans ton café ? Y m’en reste. » (chapitre Phényléthylamine, Hangover #231)
À côté de ces petits joyaux, Jolène l’autrice a le chic pour placer des scènes hilarantes, comme celle du sex-shop où Jolène la protagoniste essaie de trouver un remplacement pour son vibromasseur, décédé pour cause d’usage intempestif. L’histoire qu’elle sert à la vendeuse ne le cède en rien à la description du retour à la maison avec sa nouvelle acquisition qu’elle a hâte de déballer pour l’essayer, un peu comme une enfant qui vient de recevoir un cadeau de Noël :
J’ai enlevé ma ceinture avant de refermer la porte d’entrée. Bear au travail, je m’empresse de me déshabiller. Esti de zipper. C’est toujours dans ces moments de fébrilité qu’elle se coince. Je baisse mes pantalons. Sacré enthousiasme : j’aurais pu, en premier, ôter mon manteau. De la neige tombe sur mes cuisses dévêtues, mais je me fous du frette. Les culottes aux genoux, le corridor s’allonge subitement. Jamais ma nudité n’aura autant nui à ma sexualité. Je saute à pieds joints sur le divan en lançant par terre le sac en plastique du sex-shop. Je frémis en tenant la boîte ; excitée, il n’y a pas d’autres mots. J’ouvre délicatement. Un couvercle aimanté ; le déballer est un mouvement gracieux. L’engin, protégé par une mousse moulée à sa forme, n’attend que de me procurer des orgasmes. Multiples idéalement. Sans préliminaires, je me couche et je me l’enfonce. J’appuie sur le bouton.
Voici sans doute l’occasion pour préciser que Monogamies n’a rien, et cela malgré les one-night, les incessants massages de chatte à coups de vibro, les frottement intimes et les allusions à la taille d’un clitoris excité, d’un texte érotique. Le sexe y est présent, et bien présent – et comment pourrait-il en être autrement dans un texte qui porte la sexualité inscrite dans le titre ? -, mais celui-ci, loin d’être un outil pour exciter le lecteur à force de scènes lubriques destinées à le faire bander, ne sert qu’à illustrer le désarroi qui régit ce petit monde pris dans un cercle vicieux qui ne laisse apparaître aucune issue. Désarroi qui devient palpable dans la réponse qu’apporte la protagoniste, aux prises avec la solitude après avoir quitté ses amis, à la question posée par le titre :
Je pense qu’on reste toujours quelque part monogame : seul avec soi-même, un à un avec les autres, peu importe le nombre de personnes impliquées et la nature des relations… faque les couples ouverts ou à trois, à quatre, à mille… (Prolactine)
Serait-ce une réplique à la célèbre déclaration de John Donne : No man is an island / entire of itself ?
Et voici venu, finalement, l’instant de parler de Dolly Parton, la chanteuse country du titre, présente dans le texte, et par conséquent dans la vie de Jolène, à travers un grand nombre de réflexions à propos de sa vie d’artiste et de femme mariée, des réflexions qui tournent en grande partie autour de la tentation adultère posée par la chanson. On aimerait enfin savoir de quelle façon Dolly a pu fucker la vie sexuelle de la protagoniste, et la réponse vient comme un choc quand la Jolène du récit réalise qu’elle a franchi le pas et qu’elle n’a pas échappé, malgré son accent grave, à la malédiction de la Jolene adultère de la chanson : elle a brisé un homme, son ami, et cela juste en essayant de rencontrer quelqu’un. Un épilogue tout en amertume qui justifie amplement les réflexions désabusées de la protagoniste…
Jolène Ruest, avec ses 24 ans, a su composer un premier roman qui laisse un souvenir indélébile grâce à ces instants de voyeurisme qui donnent aux lecteurs l’illusion de faire partie de ce trio d’amis en partageant leur petites joies et leurs grandes peines, un texte qui s’impose par le calme qui y règne, malgré les majuscules, le bruit des haut-parleurs et le bourdonnement des vibrateurs, un texte qu’on adore ouvrir à n’importe quelle page, le plaisir d’une lecture toujours nouvelle et à chaque fois redécouverte étant assuré. Que ce soit dans l’appartement de Jolène, que celle-ci soit seule ou en compagnie de Pouliche ou de Bear, que ce soit dans un bar ou tout bêtement dans les rues de Montréal, on ne se lasse pas de la compagnie de cette jeune femme peut-être pas tout ce qu’il y a de plus décomplexée, mais sympa de par son côté 100% non artificiel.
Monogamies, c’est un texte qui impose son autrice comme une voix incontournable et auquel on souhaite de trouver son public de ce côté-ci de l’Atlantique aussi. Ne fût-ce que pour le plaisir de voir le public francophone ravi devant la découverte de ce que peut donner une ouverture linguistique qui ne rechigne pas devant les emprunts et les adaptations.
Après avoir parlé en long et en large de Monogamies, voici enfin venu l’instant, au moment de conclure cet article, de vous dévoiler ma version préférée du tube de Dolly Parton. Affaire de famille, me direz-vous, mais il s’agit sans l’ombre d’un doute de l’interprétation donnée par sa propre nièce, Miley Cyrus, qui excelle dans une backyard session illuminée par une voix de magicienne, la voix d’une sirène échouée dans le grand old south, sirène qui, d’ailleurs, se moque des précautions et des voyageurs trop prudents.

Jolène Ruest
Monogamies – Comment une chanteuse country a fucké ma vie sexuelle
Les Éditions XYZ
ISBN : 9782892619874