La littérature, serait-elle en train de changer ? Ou, pour être plus précis, les conditions de la production et de la distribution littéraires, seraient-elles enfin en train de s’affranchir des usages centenaires sous la pression du numérique ? Je sais que je ne suis pas le seul à me poser cette question, mais je ne voudrais pas pour autant rejoindre le chœur de ceux qui prétendent connaître la réponse. Mais quand on sait que les deux romans qui, cette année-ci, m’ont le plus marqué ont tous les deux été publiés en auto-édition et distribués en numérique, on comprend l’intérêt d’une telle interrogation. Ceux qui me suivent l’auront deviné, je parle du roman sorti de la plume enchantée d’Agnès Martin-Lugand, Les gens heureux lisent et boivent du café, et de La Légende de Little Eagle, de Florian Rochat. Et je me demande, depuis quelques jours, s’il n’y a pas un troisième titre à rajouter à cette liste : à savoir celui d’Alexis SZ, Moi l’indien, un roman que j’ai tout simplement adoré. Cela ne m’empêchera pas d’en montrer les faiblesses, parce que l’auteur mérite qu’on le prenne au sérieux et qu’on le fasse avancer, peu importe la peine, mais toutes les faiblesses imaginables n’empêcheront pas l’étincelle d’Alexis SZ de briller dans le noir.
Vous l’aurez sans doute compris, j’ai quelques réserves à propos de ce dernier texte, et pourtant, la lecture en a été un vrai plaisir : celui de la découverte d’un nouvel auteur et de l’univers qu’il fait entrevoir dès qu’il se met à écrire, multiplié par celui d’être en face d’un véritable petit bout de littérature. Ce qui n’empêche que, après avoir terminé la dernière phrase, j’ai mis un certain temps à maîtriser le malaise qui est venu se greffer sur l’enthousiasme initial.
Mais allons‑y doucement et commençons par le début. Moi l’indien, c’est l’histoire de deux adolescents, Émilie et Benjamin, qui, initialement, ignorent jusqu’à l’existence de l’autre. Habitant quelque part au milieu du patchwork communautariste qu’est devenu Paris à l’aube du XXIIe siècle, ils sont nés de parents qui, n’ayant pas réussi à prendre en main leurs propres existences minables, négligent d’autant plus leurs enfants. Ceux-ci décident, un beau jour, de se rendre maîtres de leur propre sort et prennent la poudre d’escampette, de façon aussi spectaculaire qu’ils ne laissent pas d’autre choix aux adultes que de se mettre aux trousses des deux fugueurs pour les récupérer et les faire profiter, de gré ou de force, des bienfaits d’une civilisation pourtant en train de s’effriter.
À peine sortis de Paris, les deux ados ne manqueront pas de se croiser, ou mieux : de se tomber dessus – littéralement. Cette rencontre est le point de départ d’une cavalcade bien particulière et Émilie et Benjamin s’embarquent ensemble, après les réticences d’usage en pareil cas, dans un périple qui leur fera faire le tour d’une France bien changée par rapport à ce que nous, lecteurs du millénaire encore jeune, avons quotidiennement sous les yeux. Ce drôle de pays, où les toponymes ont une consonance vaguement familière même si on ne sait où les localiser, fait partie d’une vaste entité politique comprenant l’Europe et une bonne partie de l’Asie. Les contours de celle-ci restent pourtant flous et le lecteur n’apprend pratiquement rien par rapport à l’organisation politique de la planète. S’il y bien un chapitre intitulé Trois milliards de secondes en deux temps trois mouvements dans lequel un vieil aveugle dispense aux enfants un abrégé de l’histoire du dernier siècle, celui-ci se résume en grande partie à des lieux communs et à des réponses tellement faciles que ni les enfants ni le lecteur n’en tirent aucun profit. Et c’est là qu’on met le doigt sur un des points les plus faibles du roman : le manque de consistance de l’avenir dans lequel Émilie et Benjamin sont censés évoluer. Il y a de vagues allusions à de grands changements et à des tribulations planétaires, mais tout cela reste peu clair, et le monde qu’on découvre à travers les yeux des protagonistes ressemble étrangement à celui d’aujourd’hui, avec ses vacances à la mer, ses enfants négligés, ses films et son réseau, sa vie scolaire, les coutumes de ses villages, et jusqu’aux gens qu’on y croise. Et l’auteur néglige aussi de donner les raisons d’une obsession remarquable de cette société-là, à savoir celle des enfants. Celle-ci prend de telles envergures dans le cas des deux petits fugueurs qu’il faut ramener au bercail coûte que coûte qu’on croit comprendre que l’enfance est, dans cet avenir-là, une denrée aussi rare que recherchée, mais on n’en apprend tout simplement pas les raisons. Ceci est bien dommage, parce que l’auteur se contente de la partie émergée de l’iceberg tandis que le lecteur regarde avidement la surface de l’eau qui lui cache la meilleure partie de ce qu’il y aurait à découvrir, à savoir les bas-fonds d’une société en manque de jeunesse.
Ce roman, et comment le nier après tout ce que je viens de dire, a des faiblesses, mais il y a quelque chose qui le rachète et qui me le fait ranger au nombre de ceux que j’ai nommés dans le premier paragraphe de cette note. Il y a tout d’abord la curiosité de ces deux enfants si particuliers, celle qui fait étinceler les regards d’Émilie, celle qui contamine Benjamin jusqu’à lui faire oublier son attitude blasée, sorte de bouclier entre lui et l’hostilité de ses premières années, et qui les fait pousser toujours plus loin pour découvrir l’envers des décors. Une curiosité qui non seulement emportera jusqu’au lecteur, mais sera à l’origine de la plus importante découverte de toutes, celle de l’autre, de celle et de celui, précisément, qui rend ce voyage possible. Parce que ce long roman, ce n’est pas la vision d’un avenir, ce n’est pas le doigt levé du prophète mettant en garde l’humanité contre les abus de la nature et les vices de la société de consommation, non, c’est tout d’abord le récit de la rencontre de deux jeunes gens, le classique boy meets girl, et l’apprentissage que ces deux-là font, au ralenti, de l’altérité complémentaire de deux êtres qui se rapprochent, qui se frottent l’un contre l’autre, se repoussent, apprennent à se faire confiance, à se laisser aller, à céder à des impulsions qui pourraient leur faire perdre pied, jusqu’à lâcher prise, finalement, au bout de tant d’aventures partagées et de choses vues. Et c’est là qu’est le véritable intérêt de ce roman, la perle qui brille dans le noir et dont l’éclat n’est que rehaussé par les défauts qui l’entourent, la découverte que font Émilie et Benjamin de leurs corps et des mondes qu’ils abritent derrière leurs fronts. Une découverte qui, tel le fil d’Ariane, les guide à travers les ténèbres et les fait revenir à la lumière.
La route que prennent les deux enfants se révèle être celle qu’ont prise nos ancêtres, mais dans le sens inverse, interdit, et ils apprennent à vivre avec leurs pulsions, sans avoir honte pour autant de leur nudité. Une nudité qu’ils revêtent en pénétrant dans le terrain nudiste pour y échapper aux poursuites, jardin clos à l’abri du plan S.O.S où l’innocence s’est construit un abri. Un abri d’où ils sortiront pour parfaire l’éducation, à travers leurs étreintes, de l’innocence et pour s’engager dans la prochaine étape de leurs conquêtes, celle du monde qui les attend au-delà des océans. Émilie s’embarquant avec Benjamin, c’est l’Ève éternelle qui emmène son Adam vers de nouvelles contrées promises, graines d’une race qui aura retrouvé la pureté des débuts et qui saura maîtriser le monde, quel qu’il soit. Un beau texte dont on ne se lasse tout simplement pas.

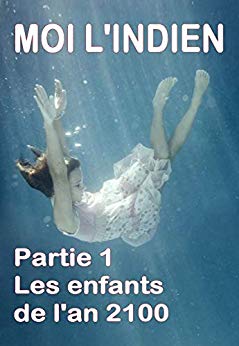
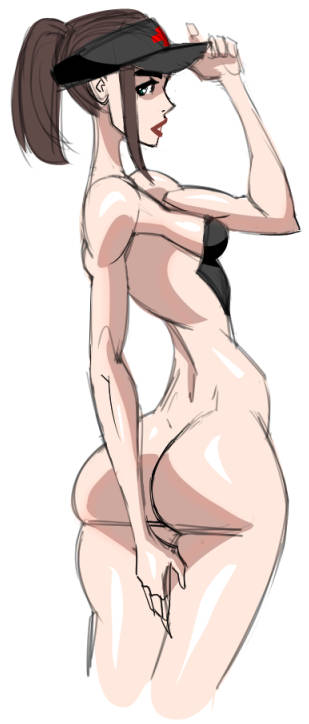
Commentaires
2 réponses à “Alexis SZ, Moi l’indien”
Merci beaucoup pour cet article ! Je suis toujours admiratif de voir des blogueurs comme vous prendre vraiment du temps pour lire, analyser puis écrire sur un ouvrage, et ce sans demande de contrepartie particulière.
Je me permets un petit droit de réponse…
Moi l’indien prend pour cadre de base un futur peu excitant pour les fans de SF et de post-apocalyptique. De fait, l’histoire se déroule dans le futur mais n’est pas un roman SF. L’idée est que la société tourne en boucle, et que notre futur dans 100 ans sera sensiblement le même qu’aujourd’hui. (C’est d’ailleurs une vision selon moi plutôt optimiste par rapport à ce qui nous attend réellement).
Cette société du futur ne tient pas à ses enfants plus que tout, en tout cas pas à deux petits fugueurs : l’enjeu est essentiellement politique car situé peu avant des élections.
Quant à l’histoire entre 2000 et 2100, elle reste certes à explorer, mais pas dans ce « Moi l’indien ». Il me fallait faire des choix, explorer un thème dans ce livre, et celui que j’ai choisi est (vous l’aviez deviné) les relations entre Emilie et Benjamin, leur évolution par rapport au monde des adultes et à la société. Il est possible que je revienne davantage sur l’histoire 2000–2100 dans un livre qui contera le passé de Ben. Cela reste à voir, j’ignore encore si je vais le faire.
Une chose qui est certaine, c’est que les éléments se seraient mélangés de façon trop dis-harmonieuse si j’avais exploré l’état du futur autant que le thème principal. Le passage d’un thème à l’autre n’est pas assez fluide, en fait je dirais : ce sont deux thèmes trop capitaux pour qu’ils soient tous deux mis en avant au cœur d’un même ouvrage.
En vous remerciant encore pour votre lecture et votre article !
Droit de réponse que je me réjouis de vous voir exercer :-) Aux lecteurs maintenant de découvrir votre texte, de voir pour eux-mêmes, et de passer quelques heures enchantées en compagnie de Ben et d’Émilie !