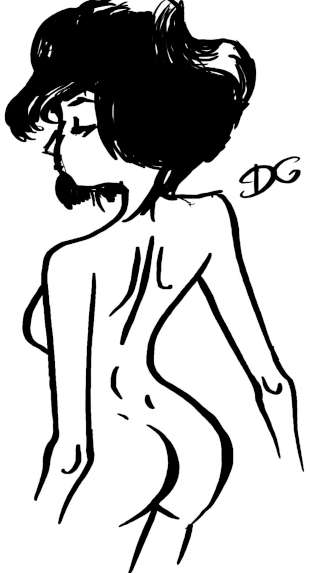Les Éditions KERO viennent de publier La Coureuse, quatrième roman de Maïa Mazaurette, autrice et blogueuse polyvalente. Si le roman ne m’a pas vraiment convaincu d’un point de vue littéraire, avec son intrigue assez banale et ses personnages dont le caractère atteint à peine à la profondeur d’un jeu d’ombre chinois, il brille par contre par une sincérité très rare, nourrie par une introspection sans égards et sans illusions, et c’est pour cela que j’en recommande fortement la lecture.
L’intrigue n’est pas bien compliquée : Une jeune femme, technomade avec un appartement à Berlin et un chez soi sur la Toile, passe quelques jours en Norvège où elle arrive à séduire Morten, « entrepreneur » danois en train de partir à la conquête des marchés américains et du « venture capital ». Ces deux-là finissent par former un couple dont le maître-mot est la conformité. Arrivée au bout de l’aventure, Maïa renonce in extremis à la réalisation de ce qu’elle avait imaginé son avenir, malgré les 20.000.000 de couronnes de Morten et la vie de jet-set. Elle aiguise ses ongles et s’en va pour reprendre sa vie de chasseuse, éternellement sur les chapeaux de roues. Mais rassurez-vous, l’intrigue est quand même moins banale que ça.
L’auteur elle même, dans une interview disponible sur le site de son éditeur, nous révèle que ce livre est en grande partie basé sur sa vie et ses expériences. Elle va jusqu’à redéfinir le rapport entre vie et littérature :
J’ai voulu que l’héroïne porte mon nom pour ne pas qu’on puisse la disqualifier comme simple personnage de fiction : cette femme solide, parfois calculatrice, et bourrée de contradictions, elle existe. Évidemment elle existe bien au-delà de moi. [1]Maïa Mazaurette nous en dit un peu plus
Il s’agit donc d’auto-fiction, un genre hybride et difficile à manier dans la mesure où le littéraire et le biographique y font ménage commun et finissent par s’embrouiller dans un nœud que le grand Alexandre lui-même aurait du mal à trancher. Si l’élément biographique peut, certes, servir de point de départ à des considérations plus générales, dépassant la petite vie de celui ou de celle qui écrit – parce que nous nous permettons de penser, contrairement à Mme Mazaurette, que la réalité n’est pas le meilleur garant de la crédibilité d’une œuvre littéraire – le contraire se produit avec tellement plus de facilité, et l’anecdote finit par peser comme du plomb dans les ailes de l’écrivain qui ne décolle tout simplement pas. C’est donc un genre difficile qu’a choisi Maïa Mazaurette pour s’illustrer, et il faut saluer le courage dont elle fait preuve.
Mais est-ce que ce serait précisément à cause de ce choix littéraire que ses personnages ressemblent à une collection de clichés plutôt qu’à des êtres humains ? À l’exception notable de Maïa toutefois, dont les réflexions et les remises en questions constituent le véritable sujet du roman. C’est là sans aucun doute un des principaux dangers du genre, à moins que ce soit, dans ce cas précis, plutôt un atout, parce que tous les projecteurs sont braqués sur cette femme dont rien ne nous échappe, et l’illumination violente arrache aux ténèbres de l’indifférence une vie façonnée en bonne partie par les séjours prolongés sur les réseaux. Vous me direz que cela n’a plus rien d’extraordinaire et qu’on risque de croiser ses voisins plus facilement sur Facebook que dans la rue, mais je doute que le voisin pousse cette expérience aussi loin que Maïa. Parce que celle-ci, consciente des conséquences d’une sorte d’omni-visibilté, d’une disponibilité à tout moment, constamment en train d’attendre le verdict du public, choisit ses actions pour mieux se fondre dans la foule de ses « congénères » numériques. Et c’est l’individualité qui en fait les frais. C’est dans ce contexte-là que la rencontre avec Morten prend toute sa valeur, parce que celui-ci la confronte à de nouvelles exigences auxquelles il faut se plier sous peine de devoir renoncer au prince charmant, dont la conquête reste, à tout moment, précaire. Ce qui revient à endosser un nouveau rôle, un de plus, avec ses attributs dont on ne sait plus si c’est un déguisement ou un trait authentique. Si, toutefois, l’authenticité existe. Le trait le plus frappant de cette mascarade est, malgré tout, le profond désintérêt que suscite l’autre, dont on ne sait même pas prononcer le prénom (p. 187 et 292). On entend, quand on se rend compte de la profondeur de l’ignorance mutuelle, comme l’écho renversé, à peine audible, de la phrase du prophète : « … je t’ai appelé par ton nom ; tu es à moi ! ». L’ego est, dans le monde de Maïa Mazaurette, tellement creux qu’il n’arrive même plus à admettre ne fût-ce que l’existence de l’autre.
On pourrait comprendre le récit de Maïa comme celui d’une femme sans qualités qui s’arrange en fonction de ses partenaires, et dont l’individualité consisterait dans la capacité de se confondre avec les rôles qu’elle est obligée de jouer. Mais dans le monde où évolue Maïa, l’individualité est une denrée rare, et ce ne sont pas que les humains qui souffrent d’absence d’identité. Il en va de même des endroits qui finissent par se ressembler tellement qu’on ne sait plus si on se trouve à Berlin, à New York ou à Lima. Les mêmes boîtes, les mêmes affiches, les mêmes sentiments, les même techniques de drague toujours pareilles, et les mêmes types aussi, au moins parmi ceux qu’on fréquente. Parce que les autres, ceux qui feraient peut-être une différence, on les évite, ils sont absents au point qu’on peut impunément oublier jusqu’à leur existence. On se demande quand même un peu pourquoi qui que ce soit se donnerait la peine de prendre un avion et de passer des heures et des heures coincé dans un siège moins confortable que ceux du bus qui relie Saint-Ouen à Aubervilliers, si c’est pour changer uniquement de … décor. À quoi donc renoncerait réellement Maïa quand elle soupèse ses choix, au tout début du récit ?
Je soupèse la possibilité encore une fois : rendre les clefs du vaste monde en échange de ce mec intérieur cuir … (p. 13)
Le monde est vaste, certes, et Maïa est bien placée pour le savoir, elle qui hante les aéroports et qui aime les avions, mais la question est de savoir ce qu’il contient, ce vaste monde. Et de ce côté-là, le récit de Maïa est celui d’une absence. Parce que, à force de plonger dans l’univers de Maïa, on ne sait plus où a bien pu passer la beauté. Ou encore la diversité. Tout ça, absorbé par la toile et son ubiquité ? Est-ce qu’il faut aller jusqu’à défendre la toile contre ses propres créatures ? Parce que tout cela existe toujours, le monde aux innombrables facettes, avec ses musées qui renferment toujours ses Joconde, ses Olympia, ses Origine et ses myriades de tableaux qui le reflètent, le monde. Avec ses églises, ses temples, ses cités, mais Maïa passe à côté de tout ça, pour se consacrer à sa chasse à l’homme. Chasse qui, ironie sublime, lui réussit si bien parce que libre des entraves de l’individualité. Ses déguisements, elle les choisit librement en fonction de la proie du moment. C’est grâce à cette faculté d’adaptation, cette mimesis, qu’elle survit, qu’elle arrive à satisfaire l’appétit de la chasseuse qui demande sa came, son ivresse. Et c’est pour cela qu’elle brise les vies qu’elle se construit, celle avec Morten comme toutes les autres, parce qu’il faut que le cercle se ferme, il faut retourner à la case départ et entrer dans un cycle nouveau, une fois la chasse terminée et la proie digérée.
Je l’ai dit au début de l’article, et je le répète, ce livre est remarquable par sa sincérité, par le regard sans préjudice que l’auteur porte sur une vie qui est, en grande partie, la sienne. Je ne sais pas si j’aurais le courage de vouloir éclairer un abîme au fond duquel il n’y a – rien. Mais encore faut-il le réaliser.
Maïa Mazaurette
La coureuse
Éditions KERO
ASIN : B01F0FONKC
Références
| ↑1 | Maïa Mazaurette nous en dit un peu plus |
|---|