À propos d’un article de Walrus Books
Le 9 janvier, un nouvel article est venu s’afficher sur le blog de Walrus Books, article où il est question de la situation du livre numérique qui, après l’enthousiasme du départ, serait tombé en « désamour » et serait même « un échec à l’échelle de l’industrie française ».
L’article, annoncé sur le compte Twitter de la maison [1]Le compte Twitter – ainsi que le site web – de Walrus Books a depuis la liquidation été supprimé, il est donc désormais impossible de consulter les tweets émis depuis ce compte. le 9 janvier à 10 h 05, s’est vite fait remarquer sur le réseau où il jouit, à l’heure qu’il est, d’une soixantaine de « retweets ». Une heure plus tard, le magazine littéraire en-ligne Actualitté l’a annoncé de son côté sur le même réseau, l’article ayant été repris dans son intégralité – sous un titre différent – par le magazine.
L’éditeur de Walrus Books, Julien Simon, vaillamment assisté – au moins jusqu’au 24 novembre 2016, date qui marque sa disparition des réseaux sociaux – par son alter ego, Neil Jomunsi, animateur de page42.org, s’est taillé une solide réputation dans le domaine de la publication numérique, ce qui, joint à sa maîtrise des outils médiatiques de la génération 2.0, lui assure régulièrement une audience de taille. On n’est donc pas surpris de voir très vite s’afficher des réactions sous forme de commentaires et d’articles en réponse aux thèses de Julien Simon.
Livre numérique vs. « objet numérique »
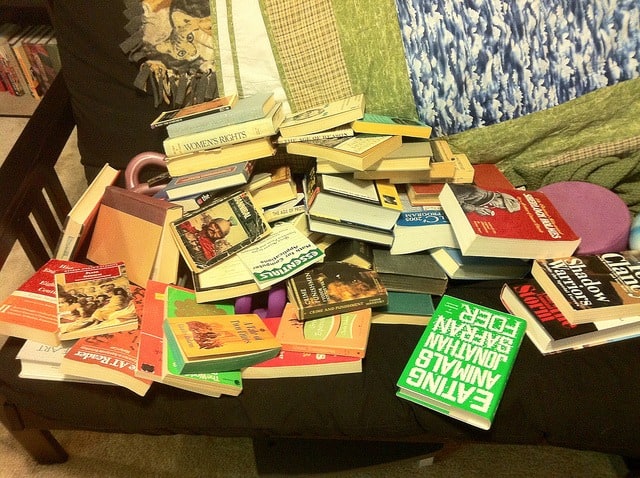
Ces thèses consistent, d’un côté, à remettre en question le terme « livre » pour désigner l’objet numérique en tant que support de texte – fausse bonne idée qui serait à l’origine d’un grand nombre de discussions assez stériles à propos de la concurrence entre livre numérique et livre traditionnel en papier – pour ensuite proposer de brouiller « les frontières entre web et livre ». Comme quoi la question du support est, une fois de plus, arrivée au centre du débat. À tort ? À raison ?
Jetons tout d’abord un coup d’œil sur l’état du livre numérique – terme que j’entends garder pour l’instant vu qu’il a fini par s’imposer. Il est vrai que la quasi-totalité des « livres numériques » que j’ai achetés ou reçus en SP (pas loin de 500 textes) ressemble drôlement à leur contrepartie en papier (si toutefois une telle contrepartie existe). Le texte est le même, évidemment, pareil pour le formatage (dans la mesure du possible), et les éléments du livre numérique sont en grande partie calqués sur ceux du livre-papier : une couverture, une page réservée au charabia éditorial (copyright, adresse de l’éditeur, numéro ISBN), jusqu’à une sorte de « quatrième de couverture » où se trouve en général un texte censé séduire le lecteur prospectif – des atouts évoluant autour de l’élément central et immuable – le texte. Autant d’éléments pour illustrer que le livre numérique et le livre traditionnel sont perçus, à la base, comme une seule et même chose : un texte qu’il s’agit de faire arriver chez les lecteurs, peu importe le support. Le choix de celui-ci a évidemment des conséquences – juridiques, par exemple, (un texte livré sous forme de fichier, propriété ou licence ? Comment éviter le partage en masse du fichier en question ?) ou technologiques (quel format de fichier adopter, comment assurer la compatibilité ?), mais cela ne fait pas disparaître le constat de base : Il y a, au cœur du débat, un texte qui se lit, un texte qui, dans la quasi-totalité des cas, est construit selon un mode hérité de – l’Antiquité. Contrairement à Julien Simon, j’arrive donc à la conclusion que le terme de « livre numérique » est un choix excellent pour désigner le texte sur support immatériel, dans la mesure où il n’y a pas de problème à assimiler un texte à un livre, des termes devenus presque synonymes [2]Quant à la Bauge littéraire, j’ai pris l’habitude d’y parler de « textes » plutôt que de « livres », mais il s’agit là surtout d’une remise en question des genres, un grand nombre de textes étant … Continue reading. Et je ne trouve rien à redire non plus aux efforts des développeurs de logiciels de lecture et de liseuses qui voudraient sauvegarder une expérience de lecture (le feuilletage, l’apparence du papier, etc.) pratiquement entrée dans les gènes. Surtout quand ces mêmes outils offrent aux lecteurs des possibilités de configuration qui permettent une lecture classique, mais aussi une lecture calquée sur celle des pages web.
Prochaine étape – le livre-web ?
Si donc l’usage du terme « livre numérique » est tout à fait justifiable pour identifier le support choisi, il me semble que la proposition du fondateur de Walrus Books est beaucoup plus qu’une question de vocabulaire. N’y a‑t-il pas, derrière la discussion terminologique, une volonté de couper les racines, d’avancer vers quelque chose de radicalement nouveau ? De dire au revoir au texte monolithique tel qu’il pullule autour de nous, que ce soit dans les rayons des étagères ou dans les médias de stockage d’un appareil de lecture ? Julien Simon, quant à lui, défend l’idée qu’il faut mettre la lecture en numérique en rapport avec le Web et ses usages :
« Le livre numérique est intrinsèquement lié au web »
Ce disant, l’éditeur de Walrus reste fidèle à une idée que la maison a illustrée de façon brillante en 2014 en lançant l’expérience Radius :
Radius est un livre-web autant qu’une expérience de lecture : plusieurs auteurs et un scénariste donneront vie au fil des semaines à cette narration en temps réel, sous forme de journal de bord. Le site est un livre, le livre est un site : les frontières entre web et ebook sont volontairement floutées. […] Ici, pas d’enrichi, pas de multimédia, juste du texte (et quelques images) : c’est par ce biais que doit passer la narration littéraire. Radius est un livre, et à ce titre, l’expérience est payante pour permettre de rémunérer les courageux auteurs. [3]Radius expérience, à propos. Mise en relief par moi.
Quelques paragraphes plus loin, on peut lire que :
Radius se lit comme un livre connecté au web. Ce n’est pas un abonnement que vous achetez, mais bel et bien un livre (et nous insistons sur ce terme).
On constate le chemin parcouru en termes de – terminologie (!) en comparant les extraits précédents à cette phrase qui se trouve dans l’article du 9 janvier 2017 :
le livre numérique n’a pas nécessairement vocation à être un livre.

À lire cela – et à bien comprendre la signification – on se rend compte que le sujet de l’article n’évolue pas tellement autour de la question du support, mais discute plutôt la notion de « texte ». Simon lui-même oppose le « livre numérique homothétique » [4]Épithète dont, en toute honnêteté, je ne saisis pas tout à fait la signification. Le contexte semble suggérer un texte avec une certaine unité, mais c’est loin d’être clair à des « objets lisibles » qu’il propose aux éditeurs numériques de créer en dehors des conventions liées à la notion du livre, en jouant « des possibilités graphiques et typographiques de l’écran ». Ceci n’a pourtant rien de radicalement nouveau, et d’autres, depuis au moins le début du XXe siècle, ont joué des possibilités « graphiques et typographiques » de l’imprimerie, ce dont certains se souviendront en pensant aux calligrammes d’un Apollinaire.
Si donc il n’y a rien de radicalement nouveau dans l’article de Julien Simon, pourquoi l’urgence qui s’exprime dès le titre, urgence qui ressemble à s’y méprendre à un mea culpa de la part d’un des protagonistes de l’édition numérique ? Pourquoi cette insistance à réclamer un changement de cap, cet appel aux confrères d’oublier « l’héritage du livre » ? Et si l’article était plutôt un cri de détressse, une mise en garde, face à la disparition d’un grand nombre de maisons du numérique ?
L’édition numérique – paysage toujours en pleine ébullition
Le paysage numérique est effectivement, une décennie à peine après l’émergence des moyens technologiques et des premières structures, toujours en pleine ébullition. Des structures naissent, vivent – ou vivotent – pendant un certain temps, avant de mettre l’arme à gauche. 2016 a vu ainsi disparaître, entre autres, House made of dawn, la Bourdonnaye et Artalys, des maisons qui ont produit des textes de qualité dont on peut trouver un échantillon dans la Bauge littéraire. Et la liste des structures ayant disparu est devenue, au fur et à mesure des années, assez longue. La disparition d’un éditeur est toujours une triste affaire, et le caractère immatériel du numérique a une conséquence particulièrement fâcheuse : Les textes concernés disparaissent sans laisser de traces, pas moyen de les récupérer du naufrage chez le bouquiniste du coin ou sur un marché aux puces.
Et il y a un autre problème, évoqué dans l’article en question dans des termes quelque peu fatalistes, celui de la visibilité des nouveaux acteurs du marché éditorial :
Personne n’en voulait [i.e. du livre numérique], aucun acteur de poids n’a donc vraiment fait d’effort pour promouvoir ce média.
Mis à part le fait qu’une très grande partie des maisons traditionnelles proposent aujourd’hui leurs textes dans les deux formats (papier ET numérique), on ne peut s’empêcher de constater, comme l’a fait Anne Bert dans un réquisitoire dressé contre le magazine LIRE, le peu d’amour que les petites structures numériques rencontrent notamment auprès de la presse, quitte à perdre toute visibilité au profit de l’auto-édition. Ce qui est évidemment un problème et peut expliquer le refus – de la part d’une partie des lecteurs – de lire en numérique quand tout ce qu’ils connaissent, c’est soit l’offre des grandes maison, souvent bardées de DRM et proposée à des prix « souvent ridiculement chers » (pour reprendre les mots de Julien), soit l’auto-édition, celle surtout à la sauce Amazon. Est-ce qu’on s’étonne encore de voir disparaître, les uns après les autres, les pure players, les maisons « nativement numériques » (dont Anne Bert parlait encore avec une telle insistance il y a à peine quelques mois) qui finissent par proposer leurs textes en numérique et en papier ? Reste à savoir si c’est là un mal, étant donné que ces éditeurs n’ont fait autre chose que réaliser que les gens ne sont pas tous pareils, et que certains préfèrent le papier. Et pourquoi s’obstiner à refuser de leur offrir ce qu’ils réclament ? Julien Simon a absolument raison quand il dénonce une approche qui consiste à défendre le livre numérique comme une valeur en soi. N’oublions pas qu’il est surtout question d’un support : et que seule l’évolution permet de s’adapter aux défis de demain et aux usages qui changent :
Ce changement n’est pas pour autant un constat d’échec, si ces éditeurs ont la capacité de publier aujourd’hui des livres imprimés, c’est parce que leur renommée s’est construite autour du numérique. [5]Élizabeth Sutton, Passer du ebook au papier : il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, interview avec Jean-François Gayrard paru dans IDBOOX le 13 avril 2016
Je comprends que les uns ou les autres puissent arriver à une vision alarmiste de la chose. Mais il ne faut pas oublier que certains acteurs de la première heure sont toujours là et continuent à se battre, comme, à titre d’exemple, les Éditions NL (avec leur patron toujours prêt à rompre une lance pour ses convictions, ce qui ne l’empêche pas de s’adapter, si la donne change), publie.net, vénérable dinosaure de l’édition initialement numérique, ou encore Walrus lui-même, un éditeur qui continue à enrichir le paysage littéraire francophone et qui n’hésite pas à proposer à ses lecteurs (er à ses auteurs) des expériences comme celle de Radius, véritable jalon de la publication numérique de ces dernières années dont il faudrait parler beaucoup plus souvent. Si les pure players ont sans doute vécu, c’est aussi parce que, en fin de compte, l’édition dite numérique n’est rien d’autre que de l’édition pure et simple, une forme d’édition que des pionniers ont eu le courage – et les moyens, grâce aux outils technologiques pas chers et aux nouvelles infrastructures – de mettre sur pied pour se lancer dans un domaine qui jouit toujours d’une renommée brillante. Un domaine qu’ils ont contribué à enrichir en ouvrant leurs portes à des autrices et des auteurs souvent peu connus ou novices.
Maintenant, l’âge des pionniers étant révolu, les nouvelles structures ressemblent de plus en plus aux petits éditeurs classiques, dont certains finissent étouffés par les grands, tandis que d’autres trouvent le courage et les moyens de tenter des expériences, comme celle de Radius (sans que je puisse savoir quelles ont été les répercussions économiques de cette expérience), ou celle encore qui mise sur l” accessibilité en équipant leurs livres (numériques, bien entendu) de dispositifs permettant l’utilisation des lecteurs d’écran, comme ACT éditions l’a fait pour une partie de son catalogue (à titre d’exemple, Le sapeur Camember de Christophe ou Les pieds nickelés de Louis Forton).
Pour conclure, il me semble ques les petites maisons – quel que soit le format de leurs livres – ont encore de beaux jours devant elles, et que l’âge du livre numérique dans sa forme « traditionnelle » (c’est à dire en tant qu’imitation du livre papier) est loin d’être révolu. En même temps, et c’est là que je rejoins Julien Simon, on est loin d’avoir épuisé les possibilités des nouveaux formats et du réseautage, mis à la disposition du monde littéraire par le progrès et la démocratisation de la technologie. Les années à venir seront passionnantes, dans la mesure où il y aura des défricheurs tels que le patron de Walrus Books.
Photo d’illustration : Juston Yost, Books being donated (CC BY-NC 2.0)
Références
| ↑1 | Le compte Twitter – ainsi que le site web – de Walrus Books a depuis la liquidation été supprimé, il est donc désormais impossible de consulter les tweets émis depuis ce compte. |
|---|---|
| ↑2 | Quant à la Bauge littéraire, j’ai pris l’habitude d’y parler de « textes » plutôt que de « livres », mais il s’agit là surtout d’une remise en question des genres, un grand nombre de textes étant difficiles à classer selon les critères traditionnels : roman, nouvelle, poème, autant de tiroirs qui permettent de ranger, de mettre de l’ordre, dans un terrain littéraire inquiétant par la créativité qui s’y exprime. |
| ↑3 | Radius expérience, à propos. Mise en relief par moi. |
| ↑4 | Épithète dont, en toute honnêteté, je ne saisis pas tout à fait la signification. Le contexte semble suggérer un texte avec une certaine unité, mais c’est loin d’être clair |
| ↑5 | Élizabeth Sutton, Passer du ebook au papier : il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, interview avec Jean-François Gayrard paru dans IDBOOX le 13 avril 2016 |

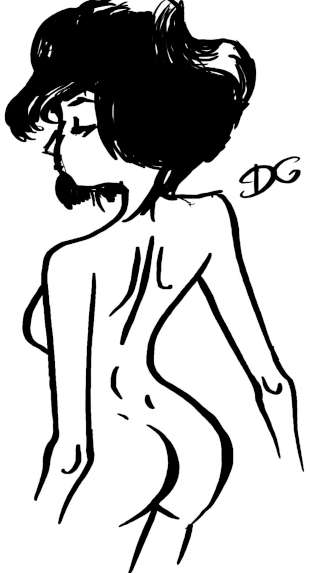
Commentaires
4 réponses à “Faut-il se débarrasser du livre numérique ?”
Je n’aurais pas mieux dit ! C’est exactement ce que j’ai ressenti à la lecture de la tribune de Julien Simon. Je me méfie toujours des appels incantatoires.
J’ai plus entendu cela comme un cri du coeur : c’est dur de faire vivre une maison d’édition et de payer son loyer avec, surtout lorsque l’on défend ses auteurs.
Et bien oui, l’édition est une sinécure lorsque l’on est un petit éditeur. Et cela, que l’on soit numérique, papier ou les deux.
Les pure-players sont seulement rattrapés par la réalité économique. Cela n’enlève rien au talent du fondateur de Walrus.
« Cri du coeur », c’est très juste comme expression. À part ça, c’est grâce à Walrus que j’ai découvert des auteurs tels que Nicolas Cartelet, Dominique Lémuri ou Aude Cenga. Chapeau donc pour le boulot de Julien !
Juste une précision sur le travail que nous avons fait sur la bande dessinée en epub, avec le Sapeur Camember et les Pieds nickelés.
Il n’y a aucun dispositif à ajouter à dans l’epub pour que les aveugles et les mal-voyants puissent y avoir accès. Ceux qui sont équipés de lecteurs d’écrans (qui se répandent aujourd’hui beaucoup plus puisqu’ils sont natifs sur beaucoup d’équipements). N’importe quel texte qui s’inscrit sur une page numérique (web, ebook) peut- être lue par ces lecteurs d’écran, et les aveugles ont donc accès à une bibliothèque infiniment plus importante que celle en braille ou en livre audio grâce à l’ebook.
C’est un progrès considérable.
Pour que ça marche, il faut que ce soit du vrai texte, pas des images. La BD représente donc une difficulté… Mais, comme pour une page web, il y a dans le code source d’un epub une balise spéciale pour insérer une image et, dans cette balise, un attribut supplémentaire qui permet de rédiger une description de l’image.
Le travail que nous avons fait a donc été de faire un epub « complet », c’est-à-dire avec le texte du sapeur ou des Pieds Nickelés retranscrit en texte vrai, et avec toutes les images décrites dans le code. Les lecteurs d’écran lisent ces descriptions qui sont cachées à ceux qui n’utilisent pas cet équipement et qui voient les images et lisent les textes.
Le travail était donc avant tout un travail de traduction des images en texte, un travail littéraire, permis par la structure même du livre numérique.
Et maintenant, bravo pour cet article !
Merci pour ces précisions ! Je suis très content de constater qu’il y a de petits éditeurs tels que vous pour exploiter au mieux les capacités du numérique :-)