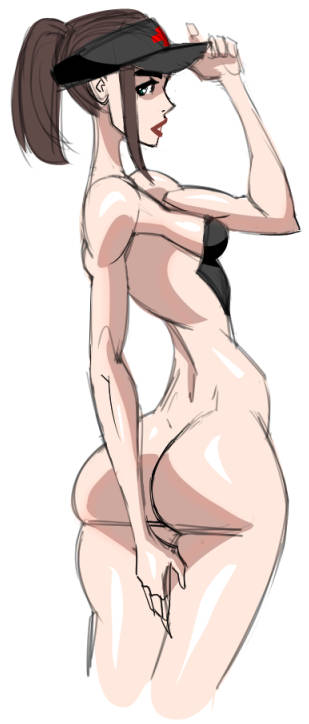C’était pourtant une belle idée, celle qu’ont conçue Astrid Monet et Ferdinand, celle de créer un recueil de nouvelles dédié aux lignes du métro parisien. L’arithmétique est certes des plus simple : une ligne de métro, un texte = 14 nouvelles du métro Parisien. Et imaginez les trésors qu’on aurait aimé y trouver : des textes consacrés à la vie souterraine de la capitale, la vie comprimée dans les artères enfouies dans le sol millénaire, une vie pénétrante, irrésistible, incarnée par les millions d’individus qui alimentent ce grand corps adipeux dont le poids malsain écrase chaque jour davantage l’Île de France. Des textes qui auraient puisé dans l’énorme réservoir qu’est Paris pour illustrer l’humanité, ses triomphes, ses échecs, ses débordements… Je l’ai dit, et je le répète, une bonne idée, une belle idée, une idée qui aurait sans doute permis de cerner la bête et de tirer au grand jour ses mystères.
Malheureusement, dans le cas du recueil en question paru aux Éditions Numériklivres, ces lignes de métro sont plutôt un prétexte, un moyen de relier par le plus ténu des fils rouge des textes en vérité assez disparates. Certes, le métro y est, avec ses stations aux noms pittoresques, ses bouches, ses couloirs, le tracé de ses lignes, jusqu’à ses odeurs qui entrent à jamais dans la mémoire de celles et de ceux qui les ont une fois respirées. Mais, dans la plupart des cas, ces éléments ne jouent que le rôle de simples figurants, de décor, d’un arrière-plan, d’une touche de couleur locale. Et les intrigues se déroulent sans que le décor y soit réellement pour quelque chose.
Admettons que les auteurs aient juste cherché un prétexte pour donner une unité quelconque à leur recueil, une marque qui puisse attirer le chaland, l’inciter à délier les cordons de sa bourse. Après tout, nous vivons bien dans une ère commercialisée et les auteurs doivent mériter leur existence comme tout le monde. Qu’en est-il donc des textes qui constituent le recueil et qui pourraient faire oublier l’enseigne quelque peu faussement prometteuse collée sur la couverture ?
Tout d’abord, un trait qui frappe : Dans la plupart de ces textes, Il y fait noir et il y fait froid, il pleut, il neige et le vent y gèle les doigts. On imagine la ville en proie à un hiver éternel, la lumière y est aux abonnés absents, les protagonistes se mettent à hanter les couloirs du métro aux petites heures du matin, et c’est souvent le dernier (ou le premier) métro qu’ils empruntent. Le décor y manque curieusement de chaleur, comme cette chambre d’hôtel sordide où le père de Jérémy se laisse sombrer dans l’alcool ou encore l’appartement vide où la belle Norah passe une dernière nuit avec l’amant qui vient de la quitter. Il y règne une ambiance propice à l’inquiétude qui se saisit des personnages, aux menaces qu’on sent peser sur eux, des menaces qui parfois se précisent sans qu’on puisse vraiment saisir leur essence et qui parfois partent – tout bêtement – en fumée, comme dans le cas de la course-poursuite entre les rails.
Certains de ces textes savent toucher le lecteur par leur simplicité, par le désespoir des protagonistes, désespoir qu’ils ne savent exprimer, entravés par le froid qui envahit le monde, un froid menaçant de gercer les vestiges d’humanité. C’est le cas de Jérémy coincé dans la chambre d’hôtel où son père s’est laissé mourir, de Norah qui ne trouve d’autre remède contre la solitude que les bras de celui qui vient de la quitter, de Marcelle terrassée par le poids des années, réduite à un seul souvenir qui retentit dans sa tête désormais vide, de Candy, jeune fille maigre qui vient de débarquer, sans repères, dans la capitale où elle ouvre son appartement et ses cuisses à un inconnu, lecteur des poèmes de William Blake, croisé dans les couloirs du métro. Ou encore de la fillette sans nom qui, la nuit de ses douze ans, sort de chez elle pour rapporter un brin de lumière à l’existence brisée de sa mère.
Et puis, il y a d’autres textes dont on termine la lecture en se demandant quels moyens l’auteur a dû mettre en œuvre pour les faire accepter par son éditeur. Les réflexions d’un prix Goncourt ? Un crime dans le métro qui, finalement, n’en est pas un ? Un cheval de course entré en relation surnaturelle avec sa jockey qu’on assassine ? L’histoire du bonhomme qui s’égare dans le métro ? Sérieusement ? N’est-ce pas hautement ironique que l’un des auteurs (Ferdinand) a trouvé les meilleurs mots pour dire mon désarroi : « À la fin, je me pose une seule question : et alors ? » (Le lendemain du Goncourt)
Je dois avouer que je n’ai pas vraiment été enthousiasmé par le recueil, quitte à être carrément déçu par certains des textes. Et pourtant, si je sors quand même de cette lecture avec un bon souvenir, c’est grâce à une fillette anonyme de douze ans qu’on ne s’étonnerait pas de croiser dans un conte de fées. Une fille que je vous invite à découvrir !
Astrid Monet / Ferdinand
Numériklivres
14 nouvelles du métro Parisien
ISBN : 978−2−89717−760−7