Il y a parfois de ces textes qu’il faut conquérir avant de pouvoir les apprécier. Mieux encore, il faut savoir se les approprier, les sonder jusqu’au fond de leurs abîmes, échouer dans leurs bas-fonds cachés, palper le verbe qui se dérobe à force de s’exhiber – des textes revêches donc qu’il ne faut pas seulement lire, mais travailler. Aristide, deuxième tome de la Saga de Mô qui a si brillamment commencé sa carrière littéraire il y a six mois avec La Meneuse, texte coup de cœur du Sanglier, appartient à cette catégorie, et il m’a fallu un travail acharné avant de pouvoir percer son mystère, un mystère qui, au lieu de te sauter à la figure pour te traîner de force dans son repère souterrain, guette dans le noir pour y attendre le lecteur assez courageux pour apprécier la beauté farouche.
Dix ans ont passé depuis les vendanges sanglants de 1960. Le cadavre de la Meneuse est bien enterré, et Mô est sorti de l’enfance. Mais le temps qui passe ne saurait abîmer les fantômes qui continuent à rôder, comme ceux de la famille belge dont l’assassin n’a toujours pas été retrouvé. Mô ne fréquente plus la Comtesse, domaine viticole et scène du carnaval grotesque et sanguinaire du premier épisode. Il s’est établi en marge de la société de Marseillan, dans un squat au fin fond de la plage, coin tranquille et à l’abri des curieux, qu’il partage avec Aristide, le géant microcéphale dont il a hérité après la mort du père adoptif de celui-ci, Manuel le berger, l’anarchiste espagnol venu s’installer dans le coin après la défaite des Républicains d’outre-Pyrénées en 1939.
Aristide, héros éponyme du deuxième volume, dont la force tellurique n’est pas sans rappeler celle d’Antée, le géant qui devait rester en contact avec la terre maternelle sous peine de crever étouffé entre les bras d’Hercule, Aristide donc qui est apparu, dès les premières lignes du premier volume de la Saga, comme l’incarnation même de la Terre [1]Il suffit de suivre le cortège des « fous de l’an mille », ouvert comme par hasard par le colosse qui porte, « cloué sur un mât » un « mannequin bourré de foin », mannequin qui sera … Continue reading, l’élément à l’honneur dans l’univers dionysiaque de la Vigne avec ses ceps gorgés de soleil et ses caves profondes, change d’enseigne et vient rejoindre Mô sur sa plagette où celui-ci habite
« une bicoque de sac et de corde, étanche comme un bateau, haubanée de bouts, ramassée, étayée du bois des naufrages et coiffée des épaves du temps »
On dirait un bout de mer échoué sur la plage, une baraque qui ressemble plus à un bateau qu’à autre chose et qui introduit, dès les premières lignes, l’élément qui marquera de son sceau le deuxième épisode de la Saga, l’Eau. Présente déjà dans le premier volume avec le Canal du Midi et le bref séjour des adolescents à la plage, elle peut maintenant être comptée au nombre des protagonistes. Mô emmènera Aristide dans des expéditions sous-marines pour y braconner, des palourdes d’abord et des amphores ensuite. Plus tard, quand les premiers doutes se seront installés à propos des jeunes filles disparues, il l’embarquera dans des expéditions insulaires jusqu’en Grèce, à Mykonos et à Amorgos où d’autres excursions maritimes viendront compléter la palette aux couleurs de l’océan. Mais l’eau, tout comme la terre, ne saurait être le domaine de l’unique beauté. La mort y rôde avec ses cadavres, que ce soit sous le soleil des îles grecques ou dans les fosses profondes que remplissent les eaux troubles du Canal de Midi.
Il y a évidemment du policier là-dedans, parce que qui dit « disparition de jeunes filles » et « cadavres » doit obligatoirement passer par « soupçon » et « enquête » avant de conclure par « condamnation », et Aristide se révèle un des héritiers du « petit Albert », l’assassin simple d’esprit de Frédéric Dürrenmatt dans la Promesse, ce requiem pour le polar de 1958. Mais Aristide est bien plus qu’un banal policier où il s’agirait de traquer le coupable. En évoquant sa région natale peuplée de personnages qu’on imaginerait tout droit sortis d’un film de Pasolini, Michel Torres en fait une terre mythologique qui s’enfonce loin dans le passé et qu’on s’étonne presque de pouvoir retrouver sur des cartes IGN ou Google, tellement on la croirait lointaine et inaccessible à tout effort autre qu’imaginaire.
Mais le mal guette au cœur même de ces terres mythologiques, tapi dans ses profondeurs – maritimes aussi bien que terriennes – et il n’y a que le feu pour les purger, le feu qui pourtant ne peut passer sans noircir et consommer ceux qui y touchent de trop près, comme le soleil qu’on a intérêt à éviter, sous peine de connaître et de partager le sort d’Icare.
Aristide, c’est un texte pétri de références mythologiques, et comment en pourrait-il être autrement, le Languedoc étant, avec sa façade maritime, une des vieilles terres méditerranéennes, terme plus en rapport avec les anciennes civilisations orientales qu’avec les réalités géographiques. Rapport souligné encore par le voyage des protagonistes dans les îles grecques et la chasse aux amphores dont la présence est la preuve tangible de l’introduction de l’espace mythologique des Anciens. Aux lecteurs maintenant le plaisir de se laisser emporter par les multiples engrenages, de percer à travers les couches successives savamment agencées par Michel Torres dans l’espoir de pénétrer jusqu’au cœur de l’énigme.
Je laisserai votre plaisir entier en m’empêchant de vous dévoiler quoi que ce soit de précis, mais soyez assurés que l’effort de suivre la construction élaborée de cet univers textuel constitue déjà un plaisir bien réel, plaisir qui s’ajoute à celui des découvertes que vous pourriez faire en suivant les traces de cet écrivain tout à fait remarquable. Aristide, c’est, au fond, un autre morceau du grand puzzle annoncé qui promet, une fois terminé, de verser une lumière inouïe de clarté sur la région que Michel Torres étale sous les yeux de ses lecteurs ébahis.
Michel Torres
Aristide
La Saga de Mô, t. 2
Publie.net
ISBN : 9782371710061
Références
| ↑1 | Il suffit de suivre le cortège des « fous de l’an mille », ouvert comme par hasard par le colosse qui porte, « cloué sur un mât » un « mannequin bourré de foin », mannequin qui sera ensuite « planté […] entre ses jambes-poteaux », invitation à tout ce monde débridé de se poser « à même le sol de terre battue ». |
|---|

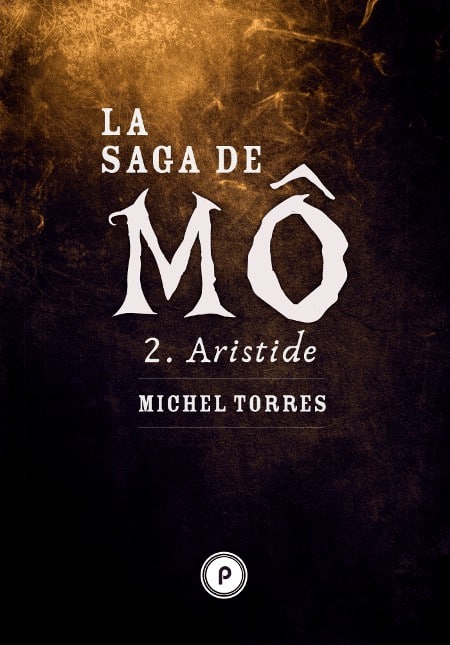
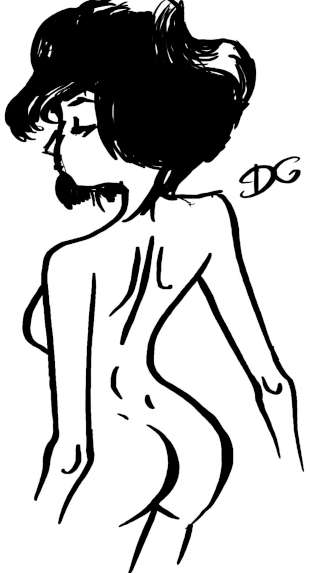
Commentaires
5 réponses à “Michel Torres, Aristide. La Saga de Mô, t. 2”
Merci au lecteur perspicace qui a su déceler ces traces mythologiques qui sous-tendent les tomes 1 et 2 et qui vont exploser dans le tome 3, « L’étang d’encre » dont voici un extrait de la 4ème de couverture sur laquelle je planche en ce moment :
Entre pillage et hommage, sur les traces des héros antiques, de l’étang de Thau à l’Enfer de Dante, vivez le voyage fantasmagorique d’Henri le pourri et de son neveu, Mô, dilué dans le désespoir comme on se perd dans un brouillard façon Zyklon B…
Le diable avait déserté l’enfer et s’était barré sans que ça change grand-chose. En définitive, les hommes géraient tout seuls et depuis bien longtemps leurs saloperies et n’avaient plus besoin du père Fouettard cornu…
Ce texte annoncé, j’espère l’avoir très bientôt sous les yeux. C’est un régal de vous lire.
La saga de Mô, tome III, « L’étang d’encre » ?
Pas lu ? Débordé ?
Désorienté ? Démuni ? Déçu ?
J’ai essayé de jeter le bouchon le plus loin que j’ai pu quitte à choquer mes lecteurs.
Votre avis, quel qu’il soit, m’importe vraiment.
Pour le tome IV « Tabarka, étang de Thau », à paraître au printemps, je repars sur les fondamentaux : un héros despérado en symbiose avec son étang malade et l’aventure qui frappe sous les traits d’une jeune beauté exotique et déglinguée…
En train de rédiger un article :-) Ayant un nouveau poste depuis le 1er juillet, les ressources que je peux consacrer à mon blog s’en ressentent, c’est pour cela que j’ai dû réduire le rythme de mes publications.
Et le voici, l’article consacré à L’Étang d’encre : http://baugelitt.eu/michel-torres-letang-dencre-la-saga-de-mo-t‑3/