Voici, avec la Légende de Little Eagle de Florian Rochat, le premier roman auto-édité qui trouve sa place dans la Bauge. Le phénomène est encore assez insolite aujourd’hui pour que je puisse le relever avant d’entrer en matière, et je peux vous assurer que la qualité du texte en question est à la hauteur de ce qu’on peut trouver dans les meilleures maison d’édition, tant au niveau du contenu (l’intérêt et la facture de l’intrigue) qu’à celui du contenant. Il y a très peu de coquilles, beaucoup moins que ce que j’ai pu trouver dans des livres édités de façon classique, et la maîtrise de la langue rend la lecture très agréable. Et quand on pense que la version numérique de ce texte est proposée pour la somme modique de 2,00 $ (sur Smashwords), cela fait rêver. La culture enfin abordable pour tous ? C’est assurément une piste à poursuivre.
La Légende de Little Eagle, c’est tout d’abord le récit d’une journaliste, Hélène Marchal, qui, suite à un héritage et la découverte d’une lettre de son grand-père, partira, presque soixante-dix ans après les faits, sur les traces d’un pilot de chasse américain, John Philippe Garreau, indien de la tribu des Pieds-Noirs, pour arracher l’histoire de celui-ci à l’oubli, un de ses buts clairement avoués étant, à part celui de collectionner les faits et les détails d’une vie, de faire de celle-ci une légende, un récit donc où « la précision historique passe au second plan par rapport à l’intention spirituelle » (article Légende de la Wikipedia). Un récit aussi qui est, comme l’auteur le fait exprimer par Hélène, visiblement inspirée par le même article de l’encyclopédie collaborative
fortement lié à un événement clé – en l’occurrence déterminant pour mon propre destin – et indissociable du personnage par lequel il est survenu. (Une légende)
Dès le début, la quête d’Hélène Marchal, célibataire près de la cinquantaine, implique les destins d’un grand nombre d’hommes et de femmes, évoqués parfois en quelques lignes seulement, mais toujours avec une telle force que ces vies-là, plantées dans l’imagination du lecteur, acquièrent une autonomie certaine. Si ce sont tout d’abord des membres de la famille de la journaliste, de nouvelles connaissances croiseront très bientôt son chemin au fur et à mesure du progrès de ses recherches, que ce soit des personnages de second ordre, comme Francis Davies, amant éphémère qui lui aura indiqué quelques pistes, ou un personnage clé comme l’aviateur Harold Holding, camarade et ami du défunt Johnny Garreau. Ce qui m’a surtout frappé, dans le traitement des personnages, aussi peu importants fussent-ils, c’est la profonde humanité qui imprègne les mots qui leur sont consacrés.
Ses enquêtes mènent Hélène d’un village bourguignon, Verdeil, jusque dans le far west américain, dans l’état du Montana et plus précisément dans la petite ville de Browning, les deux localités qui marquent le début et la fin de la carrière fulgurante de Johnny, engagé comme volontaire avec à peine 18 ans dans l’armée de l’air américaine. Mais elles la transportent surtout en arrière, dans les larges espaces de l’Ouest d’abord où, dans les années Trente, les restes de la population indienne sont tiraillées entre la culture de leurs pères (à peine cinquante ans après Wounded Knee) et celles des Blancs venus d’Europe, guettées par la misère et l’abandon ; en Angleterre et en Corse ensuite, sur les bases d’où s’envolera Johnny dans sa Mustang pour participer à l’effort de guerre, dans les mois qui précèdent et qui suivent le débarquement allié en France. Entre la naissance et la mort se déroule le panorama d’une jeunesse somme toute assez ordinaire, marquée par la fascination pour la technique, surtout sous la forme de ces appareils volants et de leurs pilotes légendaires tels l’Américain Lindbergh ou le Français Saint-Exupéry, qu’il rencontrera d’ailleurs en Corse, quelques jours avant la disparition de l’auteur de Vol de nuit.
M. Rochat, pour être à la hauteur de son sujet, s’est largement documenté, que ce soit sur la vie des Indiens dans les premières décennies du XXe siècle ou encore sur les propriétés techniques des avions de chasse. Il me semble que, visiblement fasciné par l’aspect technique de la chose lui-aussi, l’auteur se laisse aller avec parfois juste un peu trop de facilité pour suivre ce penchant-là, mais sans pour autant embêter le lecteur qui, séduit par l’intérêt humain de l’intrigue et le style toujours agréable, se laisse emporter et suit tous ces détails sans rechigner.
La vie de Johnny aurait pu être celle de tant d’autres qui ont traversé le ciel d’un continent en guerre comme des météores. Ce qui le fait ressortir, ce qui lui confère son unicité, c’est l’impact que sa vie a eu sur d’autres, impact relevé et illustré par les investigations de la narratrice, à laquelle le sacrifice de John Philippe Garreau a permis de vivre. Son histoire est ainsi une belle illustration des vers célèbres de John Donne et en même temps une leçon en humanité qui met en valeur la signification des liens, des relations, qui existent dans la vie des individus dès avant leur naissance, et qui persistent à se tisser après la mort. Et voici le côté spirituel de la légende de Little Eagle qui nous apprend que personne n’est jamais seul, et que même dans l’isolation d’une cabine d’avion, on est entouré de ceux qui nous ont précédé et de ceux qui vont nous suivre :
No man is an island, entire of itself ; every man is a piece of the continent… (John Donne, Devotions upon Emergent Occasions, Méditation XVII )
Permettez-moi, avant de conclure, une note personnelle : Je me souviens encore des longues discussions avec mon père qui m’a appris l’histoire de cette guerre qui a opposé, dans mon cerveau d’enfant, l’Allemagne au reste du monde. Et comme j’étais (et le suis toujours) Allemand, j’ai été fier de nos victoires et affligé par nos défaites. Ce n’est que bien plus tard que j’ai découvert la véritable dimension de ce conflit qui n’était pas censé régler des questions de pouvoir, mais qui touchait à la notion même de notre humanité. Qui avait été déclenchée par une bande de criminels, avec la complicité d’une bonne partie du peuple, dans le but de perpétrer le plus grand crime imaginable, à savoir l’extermination d’un peuple entier. C’est dans une telle perspective que les événements relatés par Florian Rochat prennent tout leur sens. La liberté et la paix sont à ce prix-là, et il ne sert à rien de fermer les yeux devant la cruauté et la mort qu’apporte inexorablement la guerre. Johnny est mort pour moi aussi bien que pour tous ceux qui, après la défaite des Fascistes, ont pu recouvrer non seulement leur liberté, mais surtout leur humanité.
Florian Rochat
La Légende de Little Eagle
Smashwords
ISBN : 9781465922731

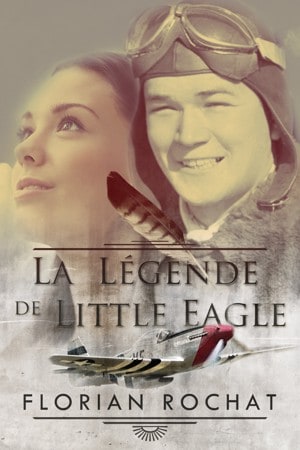
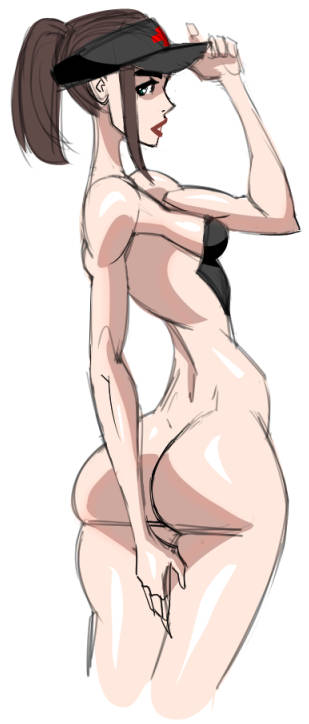
Commentaires
2 réponses à “Florian Rochat, La légende de Little Eagle – l’atroce ténacité du passé”
Poignant au fur et à mesure du récit. Pourquoi pas un film ?
Merci d’avoir laissé un commentaire. La légende de Little Eagle, c’est effectivement un texte passionnant, un texte qui, en plus, m’a fait découvrir un détail important de l’histoire de ce conflit mondial, à savoir l’engagement des Amérindiens.