Il suffit de feuilleter le catalogue de Walrus Ebooks pour comprendre que l’équipe du Morse raffole de séries. Ce n’est pas que les one shots y seraient aux abonnés absents, mais, pour faire vraiment plaisir à ce mammifère marin, il faut qu’on lui jette en pâture un ouvrage qui se décline en plusieurs livraisons. Le dernier exemple en date de cette prédilection affichée est fourni par un titre de Clara Vanely, Les fleurs du Mâle, premier épisode de la série Le Cabinet des Ombres.
Tout se passe dans un décor qui ressemble assez fort au Paris des années 70 du XIXe siècle, un Paris sous la présidence de Mac Mahon et au moins en partie sous contrôle prussien. Un Paris où évoluent des êtres venus d’ailleurs, originaires de la mystérieuse Alterre et exilés dans nos parages pour des raisons qui restent, pour le moment, inconnues : les Rêveurs. Ceux-ci ressemblent très fortement à nous autres, sauf que dans leurs veines coule, à la place du sang, l’ichor, et qu’ils maîtrisent quelques tours de main qui jouent plutôt en leur faveur, comme l’évocation, une sorte de magie leur permettant de manipuler la réalité en matérialisant des objets. Le lecteur réalise, au fur et à mesure des chapitres, que ces Rêveurs sont assez nombreux parmi nous pour constituer une véritable société parallèle avec ses propres institutions et ses propres lois. Mais, et voici le coup d’envoi de l’intrigue et des enquêtes d’Ernest Bonenfant, Rêveur lui aussi : « il ne fait pas bon avoir de l’ichor dans les veines ces derniers temps » [1]Les Fleurs du Mâle, chapitre IX – Le don, comme Camille Claudel le résume si bien et de façon si brillamment laconique face à l’assassinat d’un des leurs, le député Courcy. Oui, vous avez bien lu, Camille Claudel aussi en est, tout comme son ancien amant, Auguste Rodin. J’y reviendrai, mais ce qui importe de savoir, pour l’instant, c’est que Courcy n’est pas le seul à disparaître dans des conditions suspectes, ce qui incite le Procurateur – sorte de magistrat qui réunit sous son autorité les Rêveurs d’une région donnée – à lancer une enquête confiée au Sieur Bonenfant sus-mentionné, personnage quelque peu trouble. On devine aisément que l’enquête en question, malgré tous les efforts déployés par Bonenfant, se heurte au fait qu’on ne se trouve qu’au tout début d’une série à peine lancée, et que l’auteur aussi bien que l’éditeur ont un intérêt prononcé à la voir poursuivre son bonhomme de chemin et de lever un grand nombre de lecteurs avides de voir au-delà du cliffhanger d’usage et de connaître la suite de l’aventure. Clara Vanely adhère strictement aux usages du genre et se montre impitoyable envers ses lecteurs qu’elle délaisse, tout comme ses personnages, au milieu d’une scène de désolation, dans les décombres d’une villa soigneusement pillée par le grand méchant loup du récit, à savoir le criminel Cesare Cortese, aussi cruel que célèbre, un être dont on devine qu’il occupera le premier rang des épisodes futurs.
Le lecteur aura retenu qu’Auguste Rodin aussi est impliqué dans l’intrigue. Encore qu’il faudrait sans doute préciser qu’il s’agit plutôt d’une de ces créations, à savoir la Porte de l’enfer, gardée par Camille dans la villa des Brillants, demeure du Rodin historique que Mme Vanely se plaît à livrer aux pilleurs de Cortese. Qui s’intéresse de très près à cette Porte, parce que celle-ci semble être plus qu’une œuvre d’art et réellement donner accès à des endroits malheureusement inconnus encore.

J’ai laissé comprendre que le Paris évoqué dans le texte ressemble assez fort au Paris des débuts tourmentés de la Deuxième République. Mais il faut peut-être préciser que l’auteure a pris ses libertés avec la réalité historique. L’occupation prussienne de la France a pris fin après le paiement des réparations, en 1873. Mac Mahon a été élu président en 1873 et a démissionné six ans plus tard, en 1879. Entre ces deux dates, il n’y a eu qu’une seule Exposition universelle à Paris, celle de 1878. Mais ce n’est pas avant 1879 qu’Auguste Rodin a reçu la commande pour la Porte de l’Enfer, prévue à l’origine pour le Musée des arts décoratifs. On comprend donc très vite que, malgré des noms qui ne choquent pas dans le contexte temporel, tout cela ne cadre pas avec la réalité historique. Et voici précisément un des procédés du steampunk, genre qui adore les décors vaguement XIXe, victoriens ou édouardiens de préférence, s’empare de la réalité et lui donne un coup de pouce afin de créer des décors toujours plus déjantés. Un procédé qui demande à l’auteur une grande familiarité avec l’époque, surtout avec son côté matériel, ce qui ne pose pas la moindre difficulté à Clara Vanely, il suffit pour s’en rendre compte de relire les passages consacrés à la photographie dont Bonenfant est un adepte.
On est à peine entré dans l’univers des Rêveurs, mais on aimerait déjà savoir, un peu comme les enfants avant Noël, quelles surprises archéo-technologiques Mme Vanely nous a concoctées pour la suite. Une remarque qui vaut aussi pour l’intrigue, parce que, malgré une certaine confusion qui s’empare du lecteur face au vocabulaire quelque peu ésotérique [2]Le lecteur peut se faciliter l’accès au monde des Rêveurs en consultant, sur la page des Arches de verre, les articles du Dictionnaire Rodin de l’Éther et de l’Outre du XIXème siècle, … Continue reading que manie l’auteure pour décrire l’univers des Rêveurs, on finit par s’intéresser de près à la suite des événements, par s’accrocher aux protagonistes et à leurs aléas, et on aimerait tout simplement connaître la suite pour pénétrer plus loin dans cet univers fascinant.
Un mot, avant de conclure, à propos de l’Avertissement qui non seulement ouvre le texte, mais le place en même temps sous les auspices du grand ponte de la littérature romantique, Victor Hugo. Celui-ci, on se souvient, raconte comment une vieille inscription, un seul mot en grec ancien, lui a servi de point de départ pour construire Notre-Dame de Paris. Clara Vanely adopte ce procédé, sauf que son inscription à elle est résolument plus moderne, écrite dans la langue de Shakespeare qu’on voit fleurir sur les murs des cités et les rames du métro : We move fast. Beau procédé de la part de l’auteure qui illustre, d’un coté, sa familiarité avec une époque qu’elle déconstruit avec une étonnante facilité pour façonner les morceaux du puzzle littéraire qu’elle nous offre, et qui, de l’autre, y fait souffler une brise de modernité qui propulse le récit loin au-delà de ses racines historiques.
Clara Vanely
Le cabinet des ombres
Épisode #1 : Les Fleurs du Mâle
Walrus Ebooks
ISBN : 978–2363762528
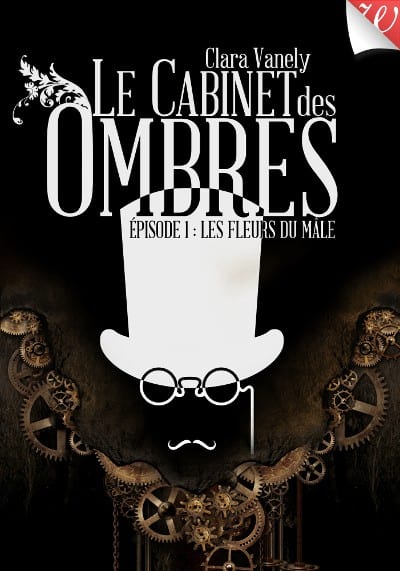
Références
| ↑1 | Les Fleurs du Mâle, chapitre IX – Le don |
|---|---|
| ↑2 | Le lecteur peut se faciliter l’accès au monde des Rêveurs en consultant, sur la page des Arches de verre, les articles du Dictionnaire Rodin de l’Éther et de l’Outre du XIXème siècle, dictionnaire que j’ai bêtement découvert au moment de rédiger cet article… |

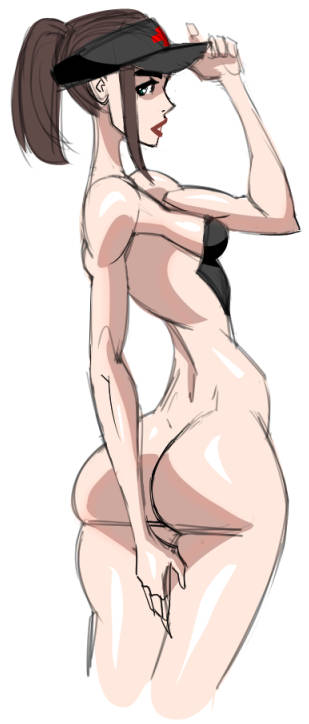
Commentaires
2 réponses à “Clara Vanely, Le cabinet des ombres : Les Fleurs du Mâle”