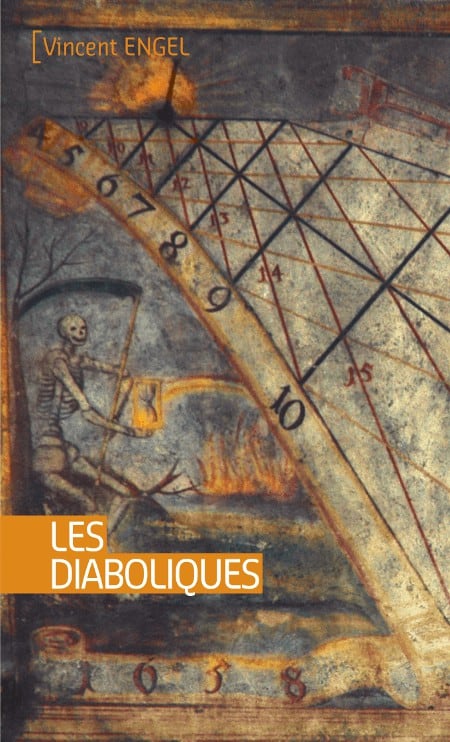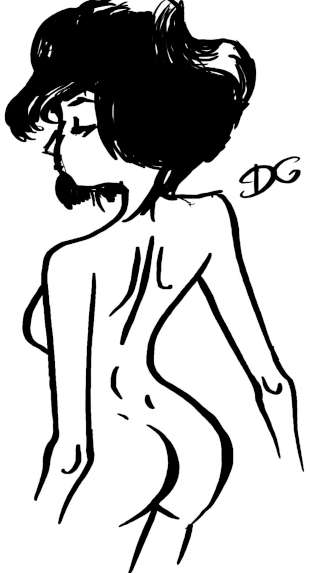Le moins qu’on puisse dire de Vincent Engel, c’est que c’est un personnage aux facettes multiples. Auteur, universitaire, critique littéraire, il est publié aux quatre coins de la francophonie, et par des maisons dont certaines figurent au palmarès de l’édition comme JC Lattès ou Fayard. Mais il ne dédaigne pas pour autant les petites maisons du cru, et il a fait confiance aux Éditions Ker, petite structure installée dans le Brabant Wallon, pour y publier son roman, Les Diaboliques, initialement paru durant l’été 2009 en feuilleton dans Le Soir [1]Carmelo Virone, L’écrivain, propriétaire ou prestataire de service : différentes façons de (mal) gagner sa vie. In : L’artiste es ses intermédiaires, Éditions Mardaga, Wavre, 2010, p. 35.
Le titre rappelle, évidemment, le célèbre recueil de Barbey d’Aurevilly qui, paru en 1874, regroupe six nouvelles dont certaines ont été rédigées et publiées dans les années voire les décennies précédentes. Les allusions ne manquent pas, et le lecteur averti y voit défiler « le bonheur dans les crimes les plus ignobles » (Troisième partie) et perçoit, derrière Marie et sa façon de mettre en œuvre son projet de vengeance, l’ombre de la duchesse de Sierra-Leone, protagoniste de La Vengeance d’une femme. On le sait, l’ingrédient principal de l’œuvre romanesque de l’auteur peu commun que fut Barbey d’Aurevilly sont les passions du cœur humain, passions constamment exacerbées par l’antagonisme des sexes qui s’acharnent à se réunir pour mieux s’entre-déchirer dans un ballet qui rappelle rien autant que l’esthétique des combats à arme blanche dont la littérature du XIXe siècle est tellement friande. Et personne n’a su en disséquer la mécanique comme le Connétable des Lettres qui prend un réel plaisir à montrer à ses lecteurs la chair palpitante fraîchement retirée des corps à vifs, quitte à la jeter en pâture aux chiens une fois la démonstration faite.
Il faut du culot pour mesurer ses forces avec un tel géant, et on peut dire que celles de Vincent Engel, si elles ne sont pas tout à fait à la hauteur du défi qu’il s’est lance à lui-même, lui permettent quand même de sortir de l’arène la tête haute.
Contrairement au recueil de Barbey il s’agit ici d’un seul texte, un roman qui raconte les aventures de plusieurs couples emportés dans un tourbillon des plus improbables où le lecteur a intérêt de s’accrocher s’il ne veut pas courir le risque de se trouver éjecté en cours de route. Le rythme des révélations – faites aux lecteurs et aux personnages en même temps – s’accélère à mesure qu’on approche de la fin, et l’idée m’est venue à plusieurs reprises de dresser un tableau des relations entre les protagonistes pour ne pas me perdre dans ce dédale dont le Minotaure résidant se nourrit de vengeance.
L’intrigue débute en plein XIXe siècle, et c’est l’histoire, si souvent remâchée, de l’amour impossible entre un frère et une sœur qui s’ignorent, séparés à la naissance. Séparés parce que conçus en dehors du cadre légitime du mariage, témoins d’une honte qu’il fallait, à tout prix, cacher. Et quand je dis « à tout prix », c’est effectivement ce qui arrive à celles et à ceux qui se trouvent mêlés, de loin ou de près, au drame, et l’histoire de ces deux jeunes personnes est comme l’illustration des malheurs qui peuvent frapper ceux qui conspirent pour garder le silence.
Les événements qui bousculent tant de vies sont contés à la première personne, et le lecteur les découvre à travers les yeux de Fabian, un des jumeaux au cœur du récit. Le départ est fourni par la révélation, de par l’abbé Ducret, unique détenteur du secret, des liens de sang qui unissent Fabian à sa sœur Lucie, rendant par là impossible toute perspective d’un amour légitime et épanoui. Le drame semble pourtant avorté avant même d’avoir pu éclater, parce que voici la sage décision sur laquelle tout le monde se met d’accord, arrêtée dans une ambiance composée de courage, de sagesse et d” « amour tout paternel » :
« désormais, Lucie et moi n’aurions plus l’un pour l’autre qu’une vive amitié et, sans rien dévoiler à nos parents, nous mettrions un terme à nos projets d’union. » (Première partie)
On se doute que ce n’est pas ainsi que peut se terminer une telle histoire, et c’est à partir de cet instant-là que tout se complique et que les apparences deviennent trompeuses. Fabian entre effectivement au séminaire, mais, ne se sentant pas le courage de diriger une paroisse, il entre au service de Gustave Morgan, fils unique d’un riche bourgeois qui se morfond dans sa position de notaire, manifestement attiré par une vie différente, sans que le lecteur puisse pour autant percer le flou qui entoure ses aspirations. Il y a pourtant une réelle difficulté dans la vie du jeune homme qui l’oppose à ses parents, celle de sa liaison avec une femme noble des environs, Viviane de Sireuille, femme dotée d’un esprit brillant, d’une grande beauté et d’une immense fortune. Et pourtant, malgré des qualités aussi éblouissantes, les parents de Gustave refusent de cautionner cette union. C’est à ce point du récit que la Grande Faucheuse se mêle de l’affaire, et elle n’y va pas de main morte. Le récit en acquiert des allures d’affaire criminelle et deux accusés vont périr sur l’échafaud. C’est au lendemain de cette affaire sanglante que Gustave quitte la région et y laisse Fabian, devenu son ami intime à travers les épreuves.
Deux ans se sont écoulés quand Fabian est mandé à Paris où il retrouve Gustave, rongé par la débauche et la maladie, près de rendre l’âme. Et voici que se présente la véritable difficulté du chroniqueur qui ne voudrait pas révéler trop de détails de l’intrigue pour ne pas priver les potentiels lecteurs du plaisir de se laisser guider par l’auteur et de voir tout se dérouler par eux-mêmes. Parce que c’est à partir de la Troisième partie et le récit de Gustave que les choses changent et que le texte prend des allures de roman noir dans la meilleure tradition des Anne Radcliffe, G.E. Lewis, E.T.A. Hoffmann ou encore des récits noirs d’Alexandre Dumas. L’auteur introduit le thème du doppelgänger et les personnages commencent à s’estomper, se dotant peu à peu d’une réalité différente, réalité inquiétante et sombre qui semble avoir guetté dans les coulisses et qui s’empare des principaux acteurs du drame. Il y a même des éléments érotiques qui viennent colorer le récit, principalement à partir de l’entrée en scène de Marie, femme débauchée s’il en est, qui n’hésite pas à s’introduire dans le lit d’un couple fraîchement marié.
Les événements que le lecteur a déjà vu se dérouler sont revisités et la réalité des faits est nuancée par un enchevêtrement de récits dans lequel celui de Gustave, rapporté par Fabian, rejoint les révélations de celui-ci. Le lecteur découvre, par la même occasion, la duplicité et le rôle capital du narrateur dans une sorte de conspiration intime et les révélations se poursuivent et se culbutent jusqu’à la fin du roman dans un renversement des rôles qui n’épargne personne, jusqu’au narrateur jeté dans le doute par une information à propos de son passé dont lui-même était resté jusque-là ignorant.
Le récit est bien mené et l’auteur a la sagesse d’éviter les interminables phrases finement ciselées de Barbey d’Aurevilly qui se faufilent comme de vivantes arabesques linguistiques entre les pages de ses textes. Le style est soigné et évite tout dérapage « moderne », l’auteur se servant de son outil principal pour recréer l’ambiance de l’époque où les événements sont censés se dérouler. M. Engel sait même dompter la complexité des relations, rendue plus compliquée encore par les rôles dans lesquels se glissent certains des personnages, et si le lecteur est parfois dérouté, c’est plutôt par le double jeu de Fabian et de Lucie et l’atrocité d’une vengeance qui ne recule devant rien.
Il y a pourtant dans ce texte quelques éléments qui dérangent et que je ne voudrais pas passer sous silence. Tout d’abord, je me pose des questions quant à la construction et au rôle du narrateur qui, dans les premières parties, n’hésite pas à mettre le lecteur sur une fausse piste. Est-ce bien là le rôle d’un narrateur / protagoniste, auteur fictif d’une sorte d’auto-biographie ? Il est difficile d’imaginer un genre de récit où le narrateur voudrait tromper le lecteur sur le rôle qu’il a joué dans les événements qu’il s’apprête à raconter, rôle qu’il dévoile d’autant plus brutalement par la suite. Les intentions de l’auteur sont pourtant claires et le procédé lui sert à créer le suspense, mais il me semble qu’il fait du tort à son personnage en en abusant de la sorte, le mettant trop visiblement au service de ses projets de romancier.
Un autre point que j’ai trouvé plutôt faible concerne les scènes érotiques. Il y en a un certain nombre dans ce roman et d’un genre que même des pornographes confirmés ne dédaigneraient pas, comme l’inceste pleinement assumé et craché à la face d’une société hypocrite, le triolisme, l’amour saphique entre mère et fille ou encore la séduction qui se sert d’un cadavre comme pour marquer au fer rouge celui qui la subit. Mais comment réconcilier une telle audace avec l’inexplicable timidité qui s’empare de l’auteur quand il s’agit de nommer un chat un chat et qui l’amène à jeter un voile linguistique sur le spectacle le plus cru :
« En lui [i.e. Gustave] parlant, elle [i.e. Marie] avait entrepris de le déshabiller et de lui caresser l’entrejambe. Ahuri, il se laissait manipuler, abdiquant mot après mot, caresse après caresse. Bientôt, il n’entendit plus ce qu’elle disait, submergé par le plaisir sordide qui montait en lui. Elle cessa de parler, dédiant sa bouche à d’autres arguments [passage mis en italique par moi]. » (Quatrième partie)
Comment ne pas sourire en lisant la conclusion du passage précédant, gardant en esprit que celle qui agit de manière aussi ferme vient d’assassiner quelqu’un ? Le courage littéraire de l’auteur est loin, ici, de faire le poids de la témérité de Marie. N’est pas auteur érotique qui veut, et M. Engel frôle parfois de très près la banalité d’un érotisme de pacotille quand il fait, par exemple, « se dresser avec arrogance des tétons glorieux » (Quatrième partie).
Les Diaboliques dans l'émission Soir Première Culture du 4 juin 2014.
Tout ça n’est pas bien grave et ne nuit en rien au plaisir de la lecture. Mais il y a quand même une question que j’ai dû me poser et à laquelle je ne trouve pas de réponse. Vincent Engel a voulu diriger l’attention de ses lecteurs sur le « grand drame sociologique du XIXe siècle qui est la bâtardise » [2]cf. l’extrait précédent de l’émission Soir Première Culture du 04 juin 2014 où Nicole Debarre présente le roman, à partir de 1:57′. Pour ce faire, il se sert d’un des plus grands auteurs de ce siècle comme modèle, il cherche à se rapprocher du style de cet âge révolu et il essaie même d’exploiter la complexité d’intrigues imbriquées à la Potocki, auteur franco-polonais qui en a fourni le modèle avec son Manuscrit trouvé à Saragosse. Mais – à quoi bon ? Tous ces efforts pour un exercice de style ? Il est vrai que le passé ne peut laisser indifférent quiconque veut comprendre sa propre époque, mais il faut tout simplement constater que les cas d’échec humanitaire comme celui illustré par le sort de Lucie et de Fabian n’ont plus aucune immédiateté contraignante pour nous autres, deux cents ans plus tard, et on se trouve devant un vide raffiné causé par l’absence des rouages qui font tourner une société. Oui, on peut se laisser emporter par l’intrigue, se perdre dans les circonvolutions de ses multiples rebondissements, mais c’est, en fin de compte, un récit inoffensif malgré ses atrocités, un récit qui ne laisse pas de traces et dont les épines n’écorchent pas. Le texte jette certainement une lumière très favorable sur l’érudition de son auteur, mais est-ce suffisant pour en faire de la littérature ?
Vincent Engel
Les Diaboliques
Ker éditions 2014
ISBN : 978−2−87586−043−9
Références
| ↑1 | Carmelo Virone, L’écrivain, propriétaire ou prestataire de service : différentes façons de (mal) gagner sa vie. In : L’artiste es ses intermédiaires, Éditions Mardaga, Wavre, 2010, p. 35 |
|---|---|
| ↑2 | cf. l’extrait précédent de l’émission Soir Première Culture du 04 juin 2014 où Nicole Debarre présente le roman, à partir de 1:57′ |