Jeff Balek, auteur vedette des Éditions Numériklivres où il s’est illustré avec la série du Waldgänger, joyeux pastiche de SF et de jeu d’action, sait manier d’autres registres aussi – et de façon magistrale – comme il l’a démontré avec Lisa, un roman d’amour, dans lequel il trouve, entre rêve somnambule et fait divers, les mots assez doux pour faire rêver et assez durs pour écorcher.
Lisa, c’est le rire si léger ; celle qui incarne l’ode à la mer, de Neruda ; ou encore « la brise de printemps […] dans l’hiver de l’existence » du narrateur [1]Jeff Balek, Lisa. Paris 2012. Éditions Numériklivres, chapitre 2. C’est celle encore qui domine de son nom le livre et les réflexions du narrateur, c’est par elle que tout commence et c’est par elle que tout se termine. Autant dire que le livre porte bien son nom.
Le narrateur se met à la première personne et nous raconte sa vie avec Lisa. Tout d’abord, et de façon tout à fait banale, c’est l’histoire d’une jeune femme et d’un homme visiblement plus âgé, « vieux mâle, […] dos argenté » [2]Lisa, chapitre 1 dans « l’hiver de [son] existence » [3]Lisa, chapitre 2. On les suit dans leurs déplacements, à la mer, dans leur chambre d’hôtel, dans le resto, et on suit leurs dialogues, leurs disputes, leurs réconciliations. Bref, on devient le témoin de leur quotidien qui n’est marqué par aucun grand évènement, jalonné des expériences de tous les jours comme tout le monde peut en faire : le divorce du narrateur, la perte de son boulot, ses démissions successives, ses tentatives de se construire une vie d’écrivain. Ou encore la vie professionnelle très peu brillante de Lisa dans son bureau où « on vieillit lentement » [4]Lisa, chapitre 15.
Mais, et dès la première page, leur histoire est surtout celle des voyages et des départs, réels et imaginaires : départ pour la mer, d’abord, celui, ensuite, pour Paris, plusieurs fois reporté. Celui de Lisa qui quitte son pays natal pour venir s’installer en France. Et ceux de leurs jeux, qui, dépourvus de limites, les emmènent bien plus loin, dans les contrées les plus exotiques, jusqu’en Afrique, en passant par l’Espagne et l’Italie.
De départs, il y en a d’autres encore, placés sous un signe plus sinistre :
Celui, social, du narrateur, emporté par un véritable tourbillon qui le fait descendre jusqu’à la perte de son appartement. Bizarrement, la menace, très réelle pourtant, de sombrer dans la misère, est comme absente de ce départ-là, de cet adieu aux conventions de la vie au sein de la société.
Ceux, finalement, de la fin, celle du narrateur et celle de Lisa, qui les rapprochent encore, malgré les directions différentes qu’ils sont obligés d’emprunter. Et c’est dans ce contexte-là que la découverte, pendant une visite au Père Lachaise, de la tombe de « Théophraste Lorgnon, voyageur », prend son entière signification. D’autant plus que celle-ci se double d’un cortège funèbre que le narrateur voit défiler, en rêve, dans un décor des Îles.
On devine quel est l’évènement censé amener la fin. Évènement de plus en plus clairement annoncé, voire demandé par les personnages qui iront jusqu’à demander à Dionysos de les emporter [5]Fin du chapitre 23 : « Et nous avons levé mille et une coupes à Dionysos. Qu’il nous emporte ! ». Sauf que le narrateur se refuse aux fins, s’accroche aux histoires sans fin. Et même s’il doit céder aux exigences de Lisa, qui demande une fin, dont elle dit que l’auteur la doit à ses personnages [6]« C’est bizarre. Pourquoi tu n’écris jamais de fin ? Tu leur dois bien ça à tes personnages ! », chapitre 24, ce n’est pas la mort, cette fin absolue, qui a le dernier mot. Et c’est ainsi, par cette fin rendue possible par les obsessions du narrateur, que le roman se termine dans un ailleurs, dans un dialogue entre le narrateur et un personnage – entre deux personnages – dont on ne sait plus très bien qui il est – ou a jamais été. Invention du narrateur – écrivain ? Personnage investi de la même « réalité » littéraire que le narrateur ? Voire spectre créé par l’auteur lui-même ?
Lisa joue avec plusieurs niveaux et le récit semble échapper à la temporalité, ce qui risque de brouiller la piste sur laquelle un lecteur voudrait peut-être s’engager. Mais il me semble que c’est là un des buts de Balek : de brouiller les pistes pour créer l’espace à part où se réfugient ceux dont la vie demande à sortir du cadre du quotidien. Est-ce qu’il aurait voulu illustrer dans quelle mesure la vie est ou peut être un songe ? Ceci renverrait bien entendu au décor espagnol / cubain et aux origines de Lisa, et confèrerait une crédibilité supplémentaire à ce roman, si léger qu’il finit par faire s’envoler ses personnages.
Références
| ↑1 | Jeff Balek, Lisa. Paris 2012. Éditions Numériklivres, chapitre 2 |
|---|---|
| ↑2 | Lisa, chapitre 1 |
| ↑3 | Lisa, chapitre 2 |
| ↑4 | Lisa, chapitre 15 |
| ↑5 | Fin du chapitre 23 : « Et nous avons levé mille et une coupes à Dionysos. Qu’il nous emporte ! » |
| ↑6 | « C’est bizarre. Pourquoi tu n’écris jamais de fin ? Tu leur dois bien ça à tes personnages ! », chapitre 24 |


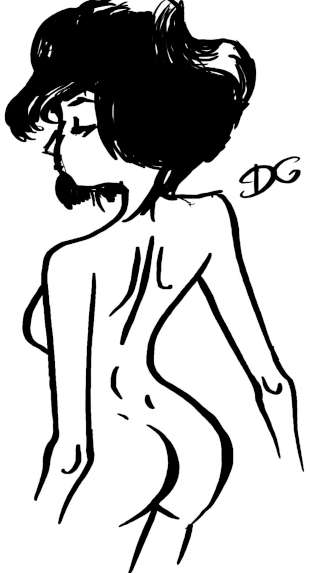
Commentaires
Une réponse à “Jeff Balek, Lisa. Le rire « si léger »”