À peine de retour de mes vacances (ce qui explique, en passant, un silence de presque quatre semaines), j’ai l’occasion de vous présenter un texte qui a été, en quelque sorte – et évidemment hors concours – une sorte de dernière lecture estivale, la saison 2016 se terminant ainsi sur les chapeaux de roue, (re-)lancée à fond la caisse par les Éditions Numériklivres et Thierry Berlanda qui nous conduisent tous les deux droit au cœur de la Tempête sur Nogales.
Si je parle de Lecture estivale, je pense, dans le cas de Thierry Berlanda, moins à l’intrigue – qui, si elle ne manque pas de chaleur, laisse peu de place pourtant aux désirs de la chair – mais plutôt aux conditions de lecture qui, elles, ont exactement répondu aux exigences que je formule depuis quatre ans pour les textes destinés à entrer dans le petit festival de la belle saison concoctée par votre serviteur : faire la crêpe sous le soleil (du Roussillon, en l’occurrence), les doigts de pieds enfoncés dans le sable, les narines remplies des effluves maritimes venant du large, l’air tout autour chargé d’un délicieux parfum de crème solaire émanant de corps chauffés à blanc, le paysage agrémenté de belles poitrines qui attirent les regards autant qu’elles attisent les imaginations.

Mais bon, laissons là les souvenirs d’un épisode estival pour revenir au désert de l’Arizona et au roman qui confronte une poignée de personnages à la misère qu’ils traînent avec eux, aux règlements de compte, à un univers sordide qui rend tout le monde égal devant la menace qui hante les têtes et les routes, à la violence sans appel des coups de feu.
Le lecteur attentif l’aura compris suite à la fin du paragraphe précédent, le texte, placé dans un décor à la Wim Wenders, rappelle, non seulement par le décor en question mais aussi par certains de ses motifs, un western, drôlement mitigé pourtant par une certaine ambiance de road movie. Parmi les éléments classiques du genre, on peut citer le combat qui longtemps se prépare et finalement éclate entre les forces qui s’opposent (on n’ose parler d’un combat entre le bien et le mal), la présence de la femme que les protagonistes se disputent, le tout rehaussé par l’intrusion / l’irruption de l’étranger, ingrédient d’autant plus inquiétant dans la mesure où celui-ci non seulement échappe aux investigations et reste obstinément opaque, mais encore se démultiplie entre, d’un côté, le gosse, Cooper le camionneur, les hommes de la Pontiac noire, et, de l’autre, la belle Jessie. Reste à savoir si l’ingrédient en question est un élément catalyseur d’une possible évolution de la société ou plutôt un indicateur d’une émergence de forces pré-sociétales, rétrogrades, vers le chacun pour soi et le droit du plus fort… Si ce dernier élément est sans doute le facteur le plus puissant, un motif qui remonte très loin dans l’histoire des civilisations, créant un lien entre un genre né au XXe siècle et les mythes de l’ancienne Grèce, en passant par la matière de Bretagne des épopées médiévales, il est aussi celui qui crée le plus d’ambiguïté dans l’intrigue de la Tempête sur Nogales, rendant illusoire la volonté de clairement distribuer les rôles en leur collant une de ces célèbres non-couleurs, à savoir le noir ou le blanc.
Si l’influence du western est donc clairement discernable comme un élément déterminant du roman, celui-ci s’enrichit d’une autre source, d’inspiration cinématographique elle aussi. Dès le début du texte, immédiatement après avoir donné la topographie de l’intrigue, le lecteur est mis en mouvement – il s’ébranle et – roule. Il ne faut pas aller plus loin que le premier paragraphe pour tomber sur cette phrase :
Vous pouvez rouler quatre-vingt-sept miles sans voir que sable et ciel.
Ça roule, donc, et ceci, à partir de la sixième phrase. Ensuite, il y a la route, les Macks (une marque légendaire de remorques), les entrepôts, les camionneurs, et le grouillement incessant de tout ce petit monde sur les routes du désert. Et il y a aussi, un peu plus tard, la Pontiac avec son équipage de noir vêtue, il y a la fuite de Jess et de William – en voiture, évidemment – et puis on tombe, à la toute fin, sur cette annonce laconique – « Il a démarré » – qui précède de très peu la conclusion – qu’on imagine suivie par le mot Fin qu’on verrait défiler sur l’écran.
Si donc western il y a, clairement et incontestablement, il y a aussi du road movie, genre dont j’aimerais vous citer la définition de la Wikipédia :
En général, le road movie montre deux compères qui quittent la ville et prennent la route en voiture, pour s’enfuir vers une destination mythique ou inconnue.
Dans un drôle de renversement, c’est sur un tel départ que se clôt Tempête sur Nogales (avec une légère variation sur le nombre de « compères »), préparant ainsi le scénario classique du road movie pour l’après-texte, invitation aux imaginations à se projeter dans l’espace laissé ainsi ouvert à l’infini.
Infini, c’est bien le mot qu’on imaginerait adapté au décor, le désert du far west, mais rien n’y est aussi limité que l’horizon, et tout se joue en comité restreint, dans un espace qui apparaît d’autant plus limité que – théoriquement – il frôle l’infini. À l’image de l’exiguïté de l’antre du voyeur, celui du Gosse, d’où celui-ci guette le moindre mouvement de sa Jessie. Dans un monde pareil, tout reste comme figé à sa place, immuable malgré le mouvement des trucks, ces bêtes de somme énormes qui, s’ils sillonnent sans cesse le désert, reviennent toujours à leur point de départ, sorte de cafards immenses cloués au mur et incapables de progresser. Et pourtant, et c’est là sans doute un des meilleurs artifices de l’auteur, tout semble évoluer autour du minuscule snack, sorte de punaise plantée en plein désert – l’œil du cyclone – et sa propriétaire, Jess, créature de rêve si visiblement téléportée dans cet endroit improbable que la question du pourquoi du comment se dresse tout de suite devant le lecteur intrigué.
La tempête qui s’abat sur Nogales, loin de se borner à un phénomène naturel, est celle qui emporte les certitudes, celle qui brouille les cartes que la vie a distribuées (ce n’est pas pour rien que les chapitres sont intitulées « donnes »), celle aussi qui fait remonter le passé de ses cendres, le passé rendu palpable dans la personne de la vieille indienne qui hante le décor comme un fantôme décharné. Mais elle n’est que la manifestation extériorisée de l’ouragan humain qui fait tourner le manège autour du repère de Jessie la blonde, celle dont le passé ne se perce qu’à coups de feu, si ce n’est à coups de hachoirs.
Thierry Berlanda a réussi l’exploit de créer un univers d’une exemplaire densité, mélange de genres qui habilement joue avec les attentes du lecteur et avec les images que des décennies d’habitudes cinématographiques ont implantées dans les cerveaux et les consciences, et dont les protagonistes se greffent sur le souvenir de ces héros du far west devenus familiers à force de les croiser dans les imaginations.
Thierry Berlanda
Tempête sur Nogales
Éditions NL
ISBN : 9782897179670


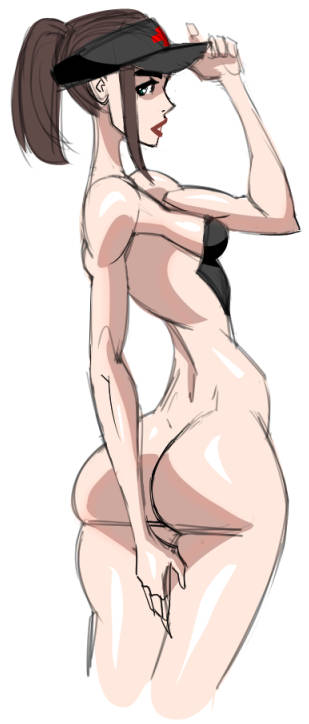
Commentaires
Une réponse à “Thierry Berlanda, Tempête sur Nogales”
Je suis bien sûr touché par cette lecture où affleure le dessous des cartes d’un roman rigoureusement immoral… Merci pour cette chronique si bien tournée, si sensible et élégante.
Thierry Berlanda