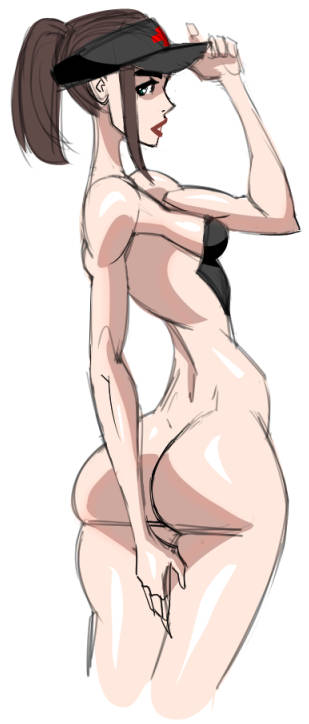Pendant que la France s’époumone à propos des Tulipes de Jeff Koons – sujet plus que frivole dans ces temps ou l’Art est remis en question par les bien-pensants trop bornés pour reconnaître un artiste fût-il en train de sonder leurs fondements – pendant donc que la France se pose des tas de questions à propos d’un artiste dont les œuvres ressemblent à des peluches vivantes plus qu’à autre chose, la censure a pris une longueur d’avance. Et – fait nouveau qui devrait inquiéter tout un chacun qui tient un tant soit peu à la liberté de l’expression et de l’Art – cette fois-ci, ce ne sont pas de jeunes enthousiastes new-yorkais décérébrés qui se déchaînent à coups de pétitions en ligne, mais bien des curateurs d’un musée qui jouit d’une renommée internationale, la Manchester Art Gallery, qui ont entrepris de bannir de leurs cimaises un tableau iconique de l’époque Victorienne, l’époque charnière de la modernité qui réunit la fin du siècle des romantiques et des industries aux débuts de celui qui a vu les plus grandes catastrophes de l’Histoire humaine. Et le tout sous prétexte que le corps de la femme y serait présenté uniquement en tant que décor passif (« passive decorative form ») ou en « femme fatale ».
Le tableau en question, Hylas et les Nymphes, s’inspire, comme tant d’autres depuis la Renaissance, de la mythologie antique en général et des Métamorphoses d’Ovide en particulier. Hylas a été l’amant d’Hercule qu’il a accompagné pendant l’expédition des Argonautes. C’est à l’occasion d’un ravitaillement qu’Hylas a été enlevé / assassiné par des nymphes, acte à l’origine d’un deuil aussi puissant qu’Hercule a dû abandonner l’entreprise des Argonautes.

On peut bien sûr se poser des questions à propos de la qualité du tableau, et personne n’est obligé de le compter au nombre des chefs d’oeuvre de la civilisation occidentale. Chaque génération est par contre obligée de se confronter à l’héritage laissé par les prédécesseurs, à la place que cet héritage doit occuper dans la mémoire – aussi et surtout dans les musées, endroits par excellence consacrés à la mémoire et à la confrontation. Celles et ceux qui fréquentent les musées en dehors des grandes expositions génératrices de sousous savent que les murs n’y arrêtent jamais de changer d’aspect, les tableaux cédant leurs places à d’autres, sortis des archives pour flairer l’air des temps modernes. Le changement fait partie de la vie des musées, et les décennies voient défiler un cortège incessant. Ce qui est prisé aujourd’hui ne l’est peut-être plus quelques années plus tard – rien de plus normal. Et ce qui manque dans les musées, ce ne sont pas les tableaux, mais l’espace pour les exposer.
On reproche donc au tableau en question de représenter le corps des femmes réduit à un rôle de décor ou à celui de femme fatale. Qu’en est-il chez les nymphes de Waterhouse ? On y compte sept jeunes femmes plus qu’à moitié immergées, les seins de plusieurs d’entre elles visibles. Toutes, elles arborent une peau excessivement blanche et des crinières brunes virant sur le rouge. La source où elles ont élu domicile est couverte de feuilles de nénuphars et une végétation luxuriante entoure les eaux. Le jeune homme est déjà en partie descendu dans les eaux, une nymphe le tenant par le bras et une autre tendant les siens vers le beau jeune homme. La couleur des vêtements d’Hylas se confond avec celle de l’eau, seul le rouge de sa ceinture le désignant comme étranger dans ces lieux. L’action est très clairement le domaine des jeunes femmes, l’homme se laissant faire, se laissant entraîner sans opposer de résistance au troupeau de filles qui l’entoure de partout. Il ne peut donc décemment être question de passivité à l’égard des femmes, bien au contraire. Et pour ce qui est d’être fatales ? Bien sûr, leur action entraînera la disparition du compagnon d’Hercule, mais est-ce qu’il mourra pour autant ?

Le maître qui a composé le panneau de la basilique de Junius Bassus a choisi de reproduire la panique qui s’empare du jeune homme quand il comprend ce qui lui arrive, et les gestes de ses ravisseuses expriment une réelle violence bien loin de ce que son lointain successeur a choisi de montrer. Contrairement au spectacle d’une cruauté inouïe offerte par la représentation antique, les nymphes « modernes » donnent l’impression de la bienveillance, comme si elles voulaient conduire le jeune homme vers un avenir meilleur, loin du règne des hommes et des armes, dans un monde plus doux et régi par d’autres lois que celles de la violence qui oppose les hommes aux hommes dans un conflit sans fin. Hylas est près d’y échapper, et les nymphes, représentantes de l’autre monde, lui tiennent la main pour l’aider. Voici une lecture bien différente de celle que semblent favoriser les curateurs de la Manchester Art Gallery, une lecture qui me semble – excusez du peu – bien plus pertinente.
Quoi qu’il en soit de l’interprétation qu’on préfère faire du tableau en question, la juxtaposition des deux représentations du sujet – séparées par 15 siècles – montre bien la pertinence du sujet à travers l’histoire. Et si cette considération ne suffirait pas à trancher en faveur du tableau de Waterhouse, on peut – et on doit – aussi se poser des questions à propos de l’opération en cours lancée par une équipe hétéroclite apparemment composée de collaborateurs du musée et de leurs « associés » (« People from the gallery team and people associated with the gallery ») [1]Presenting the female body : Challenging a Victorian fantasy. Celle-ci, si ce n’est pas tout bêtement une campagne de marketing, s’inscrit très clairement dans le mouvement né suite aux révélations ayant déclenché l’affaire Weinstein, traduit en vague #meToo sur les réseaux numériques. Tout comme la pétition visant Thérése rêvant de Balthus. L’équipe du musée a beau invoquer une sorte de défi lancé à la gueule de l’époque Victorienne, défi qui consisterait à remettre en question la façon de présenter le corps féminin, l’air est toujours chargé des relents du feu purificateur allumé par les inquisiteurs de Manchester. L’interrogation elle-même – le défi porté à la façon de représenter un sexe – est pourtant tout ce qui est de plus valable, et j’aimerais connaître les réponses apportées par les visiteurs, les internautes et la communauté artistique, mais comment ne pas comprendre que le renvoi aux archives d’une toile iconique comme celle de Waterhouse risque d’envoyer, dans le contexte évoqué, un message tout à fait dangereux ? À savoir celui de la remise à l’honneur de la censure comme l’outil de choix du politiquement correct, l’outil qui sert d’arme aux âmes trop sensibles qu’on ne saurait exposer à ce qui risque de les placer devant un défi qu’ils ne sauraient finalement pas relever ? Un outil qui remplace le débat par l’espace vide ? Un espace que les démons ne tarderont pas à investir pour y ériger les autodafés où brûleront les tableaux, les livres et les hommes. Des flammes auxquelles les petits papiers collés à la place du tableau honni ne résisteront pas.
Références