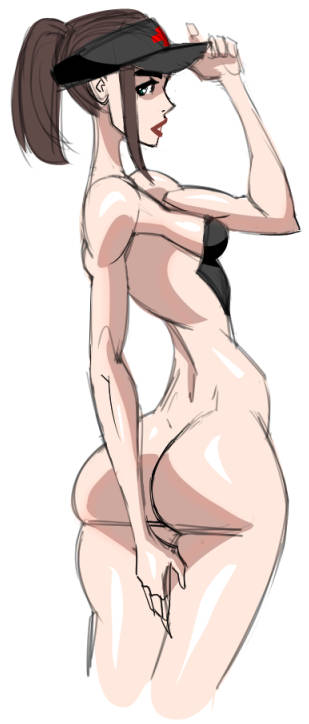Cette fois-ci, c’est bien la fin. Celle qu’on voit arriver de loin sans pouvoir s’y soustraire. On se borne à faire un constat, et ça y est. Michel Torres se sert de la langue de Shakespeare pour nous l’annoncer, cette fin inéluctable, ce qui a l’avantage considérable d’évoquer l’hymne immortel des Doors et de faire surgir des brumes les images des hélicoptères cracheurs d’un feu inextinguible dans lequel se termine un monde devant nos yeux incrédules : « This is the end ». Même pas de point d’exclamation, juste le constat, comme celui du médecin en face de la mort. Le temps des remèdes étant passé, on ne peut plus que – constater.

Dans l’univers de Mô, la catastrophe s’annonce de façon moins spectaculaire mais tout aussi inéluctable. C’est une malaïgue généralisée qui frappe le bassin de Thau et tout le littoral méditerranéen, cette mort de la flore et de la faune maritimes par asphyxie, un phénomène connu des lecteurs du tome précédent où Mô pouvait déjà constater les ravages de ce monstre qui étouffe les cris et progresse en silence :
Les eaux profondes semblaient plus chaudes. La vase fermentait ; pas la peine de rester plus longtemps, le constat était sans appel : la malaïgue gagnait les fonds. [1]Michel Torres, Skaoté, La Saga de Mô, t. 5, chap. 9, Mort annoncée
Depuis, il n’y a donc pas que la vie de Mô qui a été retournée de fond en comble, mais le phénomène connu et décrit par des scientifiques s’est généralisé jusqu’à prendre des dimensions bibliques, et certaines pages du t. 6 de la Saga de Mô ne sont pas sans rappeler les dix plaies souffertes par l’Égypte aux mains d’un Seigneur sanguinaire.
Mais commençons donc par le début, même si celui-ci, d’après l’auteur, n’est rien d’autre qu’une fin anticipée. On se souvient, on a laissé Mô dans un hôpital psychiatrique où il a été enfermé après avoir tout – littéralement tout – perdu et s’être livré une bataille en règle avec les gendarmes. Déjà en fermant ma liseuse sur Skaoté, essoufflé, je me suis demandé par quel tour de main l’auteur pouvait encore le faire sortir d’un tel pétrin, cet homme visiblement au bout de sa course effrénée, drogué et incapable d’accomplir le moindre geste sauf celui de nourrir l’araignée, un geste hérité d’une vie antérieure révolue – et perdue pour de bon. Et bien, ce coup de tonnerre, ce diabolus ex machina, c’est cette même malaïgue qui depuis le tome précédent s’est emparée du littoral entier et qui plonge la partie méridionale du continent dans une ambiance où des souvenirs de Mad Max viennent s’acoquiner avec celui du Septième Sceau, peu importe au final que ce soit celui de l’Apocalypse ou celui de Bergman :
L’étang corrompu à vomir, les vapeurs de soufre et d’ammoniaque, les mas morts en quelques mois […] L’irréalité macabre du paysage est accentuée par le plafond bas de brouillard rouge, opaque, qui a noyé le littoral et ne se lève plus, le soleil ayant renoncé à le dissoudre. [2]Michel Torres, Malaïgue, La Saga de Mô, t. 5, chap. 1, Le Corse
Mais cette fois-ci, la malaïgue, loin de se contenter de sévir au fond des étangs ou de créer une ambiance de dernier jugement en faisant planer un brouillard rouge, est bien sortie de ses confins pour envahir les terres et les villes où les hommes et les femmes meurent comme des mouches, et c’est précisément cette hécatombe qui permet à Mô de prendre la poudre d’escampette et de s’enfuir de l’hôpital – où les gardiens-soignants ne s’intéressent de toute façon plus à rien face à la mort imminente de la civilisation.
Mais, une fois libre, quelle issue pour ce marin, ce passionné invétéré des espaces maritimes, face à la mort de son habitat :
Thau, la Méditerranée et ses golfes n’étant finalement ni clairs, ni désirables, il lui faudra bien traverser cette grande mare d’eaux usées et se trouver d’autres mers, ignorées et limpides. [3]Malaïgue, chap. 1, Le Corse
Il ne reste plus que le départ, la fuite, et c’est la réflexion que je viens de citer qui est à l’origine de la cavalcade qui l’emmènera loin des rives de l’Étang de Thau, jusqu’au roc de Gibraltar, à l’orée de l’immensité océane de l’Atlantique, une cavalcade qui lui fera traverser une Languedoc et une Espagne mises à feu et à sang, en proie aux brigands et aux vieux démons, les gouvernements en guerre contre leurs peuples. Et comme il s’agit de Mô, il faut ajouter à tout cela une dose de surnaturel pour rendre son enfer complet, et les poursuites de Bad, la bête infernale lancée à ses trousses pour venger la mort de la guerrière celte, font pendant à celles des humains. Mais l’auteur ne peut se résoudre à laisser son protagoniste mettre le cap sur le sud sans lui avoir fait faire le tour de tous ces lieux hantés pendant les aventures précédentes, et on voit Mô traverser une dernière fois sa lagune, visiter ce qui reste de sa cabane, rendre visite aux compagnons, de bonheur les uns, de malheur les autres, et cette tournée des adieux est l’occasion pour le lecteur de renouer une dernière fois lui aussi avec les lieux que l’écriture de Michel Torres et l’intensité des émotions de Mô ont fini par rendre éternels.
Après les lieux, c’est au tour d’une ancienne amante de refaire surface et de sortir des eaux troubles du passé : Liu, la sirène aux traits asiatiques surgie des fonds au début de Tabarka, le quatrième tome de la saga, disparue dans le décor quelques chapitres plus tard après avoir tenu compagnie à Mô pendant un bout de route, Liu que tous les efforts déployés par son amant n’ont pu arracher au noir de l’inconnu. Maintenant, à deux pas de l’Enfer, elle se dresse devant lui, le physique abîmé et le mental près de foutre le camp, contrepartie féminine de ce qui est arrivé à Mô au cours des décennies – passée par d’autres malheurs avec sur la route d’autres crimes et d’autres connards, mais visiblement en mode fin de route. Malgré – ou justement à cause – des cicatrices laissées par un passé plus souffert que vécu, Mô emmène l’ancienne amante dans sa quête d’un ultime départ vers des eaux plus salubres, un périple à travers un continent bouleversé. Pour échapper, un seul moyen, Joëlle la « Nemo femelle » [4]Michel Torres, Skaoté, La Saga de Mô, t. 5, chap. 13, Le trimaran et son trimaran croisés au tome précédent et en route pour le détroit. Désormais, c’est une chasse au fantôme pour la rattraper et essayer de faire équipe commune. Et si cette chasse n’a rien d’un trip de plaisir, Michel Torres sait quand même y glisser des éléments drolatiques comme l’épisode des moines détrousseurs, une rencontre qui fait exploser Mô dans un accès de colère qui lui fait prendre des accents dignes d’un capitaine Haddock :
Bande de pourris, cinq salopards déguisés en moines, la confrérie des détrousseurs et des sans-couilles à cinq contre un. C’est quoi votre ordre, les détrousseurs du Tout-Puissant de l’apocalypse Rouge ? [5]Michel Torres, Malaïgue, chap. 7, Caius Domitius Aenobarbus

Le fait que ceux-ci aient élu domicile dans l’abbaye de Fontfroide, un des hauts lieux d’un tourisme qui refuse de dire son nom en se cachant derrière ses prétentions culturelles, ne fait que renforcer le côté hilarant de la rencontre, même si cela n’adoucit en rien la misère des personnages. Mais pourquoi pas alléger le fardeau des lecteurs emportés dans le tourbillon d’une colère impuissante vers un but dont on ne devine que trop le caractère final,
un aléatoire rendez-vous à enquiller avant le portail de l’Enfer qui les poursuit et les espère, grand-ouvert à deux battants. [6]Michel Torres, Malaïgue, This is the end
Ce dernier rendez-vous, et comment en serait-il autrement pour conclure une vie passée tout entière au rythme des vagues et des tempêtes, Mô s’arrange pour l’avoir avec l’océan, ce dernier refuge quand tout espoir s’éteint, se faufile entre les doigts comme l’eau que rien ne retient.
La saga se conclut donc dans une ambiance de fin de monde, ce qui finalement convient à une vie placée dès le départ sous le signe de la violence et la de cruauté de ses congénères. Une vie où il y a certes eu des instants adoucis par la tendresse et la passion, des instants qui évoquent les noms des filles et des femmes que ce grand sauvage a pu croiser : Malika, Liu, Skaoté – Liu encore. Mais le sort ne voulait pas le lâcher et s’acharnait à rendre impossible toute issue autre que par la violence. Dans la Saga de Mô, si les femmes ne sont pas les grandes absentes, leurs existences n’y sont qu’épisodiques et se terminent entre les mains des assassins.
La Saga de Mô est, en grande partie, un hymne à la beauté du sud vu à travers les yeux de son protagoniste, que ce soit la lagune, les vignes, la voie Domitienne ou encore les vastes paysages sous-marins, inaccessibles au commun des mortels. Et on devine trop de points communs entre l’auteur et le protagoniste (des plongeurs invétérés tous les deux) pour ne pas y voir s’exprimer l’amour de Michel Torres pour son sud à lui. Et on devine son désarroi quand on tombe sur un article, déterré grâce à quelques recherches rapides pour mieux saisir le phénomène, consacré à la résurgence de la malaïge, et pas plus tard qu’en septembre 2018 ! C’est dire que j’ai passé mes vacances à une bonne centaine de kilomètres des endroits frappés de plein fouet par cette mort en catimini. Mais M. Torres, tout comme Mô, a pu voir les effets là où d’autres yeux ne pénètrent pas, près des fonds, où le phénomène prend son origine et se manifeste loin du grand public. Et comment rester de marbre face à cette catastrophe ? Et c’est sans doute cette colère-là qu’on voit à l’œuvre quand l’auteur s’applique à détruire ce monde construit – et rendu – avec une telle passion. Quand Mô quitte la scène pour de bon, est-ce que c’est le pressentiment de l’échec commun ? À chacun de donner sa réponse, selon sa nature plus ou moins optimiste. En attendant, ce dernier voyage de Mô et de Liu, en route pour échapper aux poursuites de la bête et aux miasmes assassins et qui ne trouvent d’autre solution que d’embrasser les profondeurs, dans un dernier coït aussi spectaculaire que final, c’est un peu le passage d’un météore dans le ciel nocturne de notre orgueil mal placé, la fin d’une carrière souterraine rebondissant dans un dernier sursaut. Pour finir en beauté – une fois pour toutes.
Michel Torres
Malaïgue. La Saga de Mô, t. 6
Publie.net
ISBN : 9782371771963
Références
| ↑1 | Michel Torres, Skaoté, La Saga de Mô, t. 5, chap. 9, Mort annoncée |
|---|---|
| ↑2 | Michel Torres, Malaïgue, La Saga de Mô, t. 5, chap. 1, Le Corse |
| ↑3 | Malaïgue, chap. 1, Le Corse |
| ↑4 | Michel Torres, Skaoté, La Saga de Mô, t. 5, chap. 13, Le trimaran |
| ↑5 | Michel Torres, Malaïgue, chap. 7, Caius Domitius Aenobarbus |
| ↑6 | Michel Torres, Malaïgue, This is the end |