En mars 2010, un bon siècle après les événements qui y sont relatés, Dominique Simon a fait paraître, aux Éditions Fayard, Les Carnets d’Alexandra, sorte de journal fictif d’une jeune femme du début du XXè siècle qui y aurait consigné les événements et les réflexions l’ayant amenée à se rendre compte de son homosexualité, à l’assumer et – finalement – à la vivre. On peut donc dire que, par certains côtés au moins, le texte de Dominique Simon n’est pas vraiment moderne, dans la mesure où l’auteure non seulement place son intrigue à un siècle de distance, dans une époque certes souvent évoquée depuis le centenaire de la Grande Guerre, mais néanmoins assez éloignée de la nôtre par une multitude d’aspects, et qu’elle se sert d’une sorte de supercherie littéraire dont les titres de noblesse remontent à l’âge romantique, un procédé consistant à faire passer un texte fictionnel pour des notes personnelles du protagoniste, une sorte de journal (signification implicite des Carnets), ce qui lui confère l’authenticité du vécu, du non-fictionnel, tour de main littéraire permettant aux personnages de se glisser dans un cadre authentiquement historique (dans la mesure, bien entendu, où l’auteur a su faire aboutir ses recherches) et d’intégrer, en quelque sorte, la réalité du passé. Il ne faut pourtant pas oublier qu’une telle approche est toujours un sacré défi que l’auteur se lance à lui-même, à savoir celui de recréer l’ambiance d’une époque révolue qui n’est pas la sienne, et de se tenir en équilibre sur le fil ténu entre la reconstitution historique d’un côté et la vérité littéraire de l’autre, deux domaines pas forcément compatibles. Le risque étant, évidemment, d’échouer sur les deux fronts à la fois.
Roman de l’individu différent
Si Les Carnets d’Alexandra n’est donc pas forcément, par la forme au moins, un texte moderne, le sujet – l’homosexualité – reste par contre d’une actualité cuisante, ce qui, après tout ce qui a déjà été dit et écrit à ce propos, pourrait étonner certains, voire les conduire à de fausses conclusions à propos de l’état d’esprit de la société. Il semblerait, par exemple, que l’entourage de M. Hollande n’ait pas correctement prévu la violence des réactions d’une assez grande partie de la société suscitées par le projet du Mariage pour tous, projet pourtant ouvertement annoncé dans la campagne présidentielle. Mais ne nous trompons pas, les Carnets ne sont pas politiques dans la mesure où l’auteure y formulerait des revendications, elle se contente d’illustrer. Il ne faut pas oublier non plus que le texte a été publié à un moment où, après la prise de position de Mme Royal dans la campagne présidentielle de 2007 ou les revendications de la maire de Montpellier deux ans plus tard, la question des droits des homosexuels était très présente dans le débat public. Que l’auteure ait voulu participer à ce débat en publiant un texte inspiré d’un sujet d’actualité ou qu’elle ait tout simplement voulu en profiter pour faciliter sa commercialisation, peu importe du moment qu’il y a un traitement littéraire du sujet. Et comme le sujet se confond avec les revendications de l’individu, il me semble qu’on aurait tort d’affirmer que l’élément politique n’y serait qu’accessoire ou simple moyen de marketing. La protagoniste, une femme homosexuelle, réclame avec une verve et une violence remarquables, son droit à la différence, et voilà l’élément qui donne sa valeur au roman, l’interrogation à propos de la place de l’individu « différent » – par quelque côté que ce soit – dans la société, interrogation fondamentale dans un type de société de plus en plus centré sur l’individu, l’élément de base du nouveau tissu de la structure sociétale des États occidentaux. Interrogation à laquelle il faudra revenir – après avoir passé en revue les Carnets d’Alexandra.
Un détail tout d’abord, la jeune protagoniste de ces Cahiers ne s’appelle pas vraiment Alexandra. L’héroïne reste anonyme, endossant par cela un rôle plutôt qu’une individualité (ce rôle étant celui de l’individu, il n’y a pas de contradiction avec ce que je viens d’affirmer dans le paragraphe précédent), celui de la femme dans la société, de la femme qui se rebelle contre les conventions. Et elle a opté pour un pseudonyme particulièrement bien adapté, c’est le cas de le dire, à sa situation, à son caractère et à son parcours dont une grande partie consiste à se conquérir une liberté fortement compromise par le mariage et les prérogatives masculines prévues par la législation de l’époque. Alexandra, c’est un véritable nom de code que la jeune femme s’est attribué comme toute vraie combattante, un nom de guerre signifiant celle qui repousse les hommes, du grec ἀλεξειν (alexein), « repousser, combattre » et ἀνηρ (aner), ἀνδροσ (andros), « homme ». Cette liberté pour laquelle elle se bat, c’est, d’un côté, la liberté juridique, mais c’est surtout la liberté physique, une liberté tout intime, à savoir celle de son corps, celle de choisir ses partenaires, celle aussi de se refuser à celui qui se croit du bon côté de la loi en demandant à la femme de remplir les obligations sexuelles qu’elle aurait contractées, par le mariage, envers lui.
À la conquête d’une liberté intime
Une grande partie du texte est donc consacrée à la conquête de la liberté physique, conquête au seul niveau individuel avec des implications sociales très indirectes. Et il ne serait pas faux de dire qu’Alexandra se révèle, dans ce contexte, une sorte de monstre, une prédatrice sexuelle. Accordant une priorité absolue à son seul plaisir qui commande en maître aux relations qu’elle entretient avec ses semblables, elle séduit des jeunes filles d’à peine treize ans sans se préoccuper le moins du monde des conséquences de ses actes, et elle n’hésite pas à faire tomber dans des pièges élaborés les inopportuns qui se trouvent entre elle et la réalisation de son plaisir. Il ne faudrait pourtant pas oublier qu’on parle ici d’une femme piégée par les conventions d’une société où le tribadisme était considéré comme un crime menant tout droit devant le juge et en prison. Comment donc s’étonner de ce que son attitude envers elle-même et sa relation avec les autres en soit fortement orientée – dans un sens qui fait passer l’ego avant tout ? On doit pourtant lui concéder qu’elle ne rechigne pas devant une bonne action quand l’occasion se présente, celle par exemple d’accepter à son service une fille revenue de Paris avec une réputation sérieusement entamée suite à des actes de libertinage et de prostitution. Qu’Alexandra ait destinée celle-ci à faire partie d’un ménage à trois (tout au féminin) ne saurait enlever tout mérite à sa proposition qui permet à la jeune femme de se reconstruire une « situation ». Une autre de ses « bonnes actions » se situe sur un tout autre niveau, à savoir son engagement pour une inconnue, une prisonnière dont elle apprend le sort par pur hasard, pendant un tour en ville pour y faire des courses. C’est cet engagement-ci qui lui permet d’accéder à la dimension sociale, de devenir un être social capable de réagir de façon désintéressée, de mobiliser tout un réseau de relations dans un complot à la Dantès.
Alexandra évolue ainsi entre deux pôles, l’ego et la société, montrant à tour de rôle des facettes de sa vie et de son caractère dont certaines se révèlent assez troublantes. Et comme c’est en première ligne sa sexualité qui constitue la différence par rapport à la norme, il ne faut pas s’étonner du fait que c’est le domaine mis en avant par l’auteure. Dominique Simon fait donc assister le lecteur au réveil de l’homosexualité de la protagoniste, aux expérimentations de celle-ci, à ses interrogations et à ses premiers pas sur un terrain inconnu. Un tel récit initiatique est un des procédés classiques quand il s’agit de l’amour entre femmes, que ce soit dans la pornographie ou en littérature, une approche qui fournit un grand nombre d’occasions de parler cul, de se nourrir de l’embarras des personnages, de leurs réticences surmontées, des délices de la séduction rendues plus épicées encore par un interdit qui, aujourd’hui encore, peut entraver les individus dans la libre expression de leurs pulsions sexuelles. Curieusement, on n’a pas vraiment l’impression d’être dans un texte érotique, malgré le caractère très explicite de certains passages. Est-ce parce que le sexe est juste un moyen pour illustrer certains côtés du caractère de la protagoniste ? Celle-ci n’arrête pas de souligner l’importance du sexe, d’évoquer l’amour entre femmes, seul capable de lui permettre de s’épanouir, de s’affirmer dans sa liberté. Et c’est sans doute cela, ce caractère en grande partie utilitaire du sexe, qui empêche celui-ci de trouver toute sa force, de devenir véritablement sensuel, et de faire des Carnets d’Alexandra un texte érotique.
Teneur politique compromise par l’usage de clichés
Il me semble pourtant que la principale critique qu’on peut adresser aux Carnets d’Alexandra est celle de faire de l’analyse historique et sociale un prétexte, de renoncer à pousser plus loin l’effort de montrer l’individu aux prises avec la société dans ce qu’il a de plus intime, sa sexualité, un conflit pouvant mener jusqu’à l’immoralité, et de compromettre la teneur politique du texte par des faiblesses littéraires en ayant recours à des clichés (la bonne qui sombre dans la prostitution, la femme innocente envoyée en prison) donnant au lecteur l’impression d’avoir été transporté dans un roman d’Eugène Sue ou de Dumas Père. Mais comme il n’est pas donné à tout le monde de transformer pratiquement tout en littérature, on risque très fort de se casser la gueule.
Le texte a pourtant attiré une certaine attention – il en existe une traduction portugaise et une adaptation théâtrale (dont je ne saurais dire si elle a jamais été montée sur scène), il a servi comme illustration à des papiers intéressants, comme celui dédié au rôle de l’homosexualité dans la rencontre des classes, il a soulevé des controverses du côté de certaines activistes lesbiennes, et de nombreux reproches lui ont été adressées, comme celle de la « platitude », se limitant trop souvent aux codes ou aux descriptions anatomiques :
« L’érotisme se limite trop souvent à des codes, des récits plats et pornographiques. Les descriptions anatomiques de la chair et des gestes de l’amour sous toutes leurs formes lassent, faute de sentiments, à l’image des pages les plus brûlantes des aventures du Prince Malko […] ou dans le premier roman de Dominique Simon, Les carnets d’Alexandra (chez Pauvert). Exemples de platitudes […] dans Les carnets d’Alexandra : « Marie releva ma robe pour passer sa main entre mes cuisses et, sans pour autant me dévêtir, trouva, étant femme, très facilement le bon chemin (…) Déjà je ressentais entre mes jambes une humidité qui annonçait le plaisir que je prendrai bientôt » [1]Emmanuelle De Boysson, La littérature érotique : entre émotion et surprise.
Quant à moi, j’ai trouvé la narration parfois assez malhabile, comme si elle servait plutôt à illustrer des idées qu’à raconter une histoire, et certains artifices du langage censés sans doute donner au texte un air d’authenticité, comme par exemple dire « avoir besoin de ce que l’on sait » pour exprimer le besoin d’avoir un rapport avec un homme, ou « poser ma bouche où l’on sait » pour désigner, on le devine, un cunnilingus, ou encore – un comble – parler de « leur plus sensible », pour voiler le sexe derrière une expression tout à fait inadéquate (dans un roman, rappelons-le, lesbien), ont eu le mérite de finir par considérablement m’agacer. Comment imaginer qu’une femme de la trempe d’Alexandra n’ose confier à son journal (!) les mots pour clairement désigner les choses ? C’est d’un maladroit… Et pourtant, l’ensemble donne un texte qui laisse de bons souvenirs, celui surtout d’une protagoniste assez équivoque que le lecteur a du mal à cerner dans toutes ses dimensions, un être qui sort de l’intrigue et continue à vivre dans les têtes des lecteurs, ce qui n’est pas un mince exploit. Alexandra est devenue, sous la plume de Dominique Simon, un individu dont la quête d’un parcours à suivre, d’une place à remplir, acquiert une valeur exemplaire. C’est sans doute pour cela que le texte est, malgré ses points faibles, un franc succès.
Références
| ↑1 | Emmanuelle De Boysson, La littérature érotique : entre émotion et surprise. |
|---|

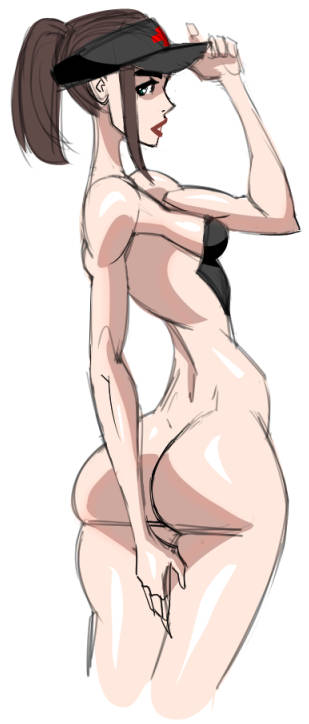
Commentaires
2 réponses à “Dominique Simon, Les carnets d’Alexandra”
A lire absolument… Personnellement j “ai trouvé cela vraiment intéressant, enrichissant même en tout cas pour ce que je connais du sujet sans équivalent. Bien sûr si c’est à chacune de voir selon sa sensibilité, souvent je me suis retrouvée en elle et elle racontait le plus naturellement du monde des situations que j’avais moi même vécu sans pourtant que je n’ai jamais osé en parler à personne. Alors presque je suis soulagée de savoir que d’autres ont ressentit ou ont effectivement eu des pratiques que par pudeur et peut-honte aussi j’ai gardé à ce jour encore secrètes. Et dont même mon amie n’a connaissance malgré nos sept année de vie communes . Alors oui j’ai beaucoup aimé…
En relisant la très bonne étude publie ci dessus, je me permets pour beaucoup de raisons philologiques surtout d’émettre des doutes sur la rubrique « roman » dans laquelle ce texte est sorti chez Fayard. Pourquoi ? En premier parce que il est très difficile sur un texte long de pas introduire de fautes au niveau des expressions usitées à l’époque et je n’en ai trouvé aucunes. Sans multiplier les exemples en voici un très significatif la formulation de la locution entres jambes avec ou sans tiret . d’autres et beaucoup de plus rarement employées sont tout aussi parfaitement employées et orthographiées. Mais ce n’est pas la seule raison je certifie que plusieurs fois il est avéré que chez de pourtant grand éditeurs on préfère lorsque cela est possible pour des manuscrits dont ont ne connais pas vraiment l’origine bien qu’un ayant droit soit mentionné le publier dans la rubrique romanesque car comme cela légalement d’éventuels ayant droit auraient grand mal de se manifester ne serait ce que pour en interdire la publication. Car comme vous l’avez remarqué il n’est pas possible même de tenter la moindre localisation tout les noms ont été scrupuleusement effacés de ce texte venu de nulle part et dont l’auteure ou plus sûrement selon moi l’ayant droit n’a pas la moindre photo sur internet ni non plus le moindre curriculum vitae malgré les pourtant éditions et traductions successives. Comme moi sans doute vous pourrez vous demander pourquoi après un tel retentissement personne ne se manifeste pour en revendiquer la maternité… Plus authentique selon moi qu’on ne pourrait le penser…