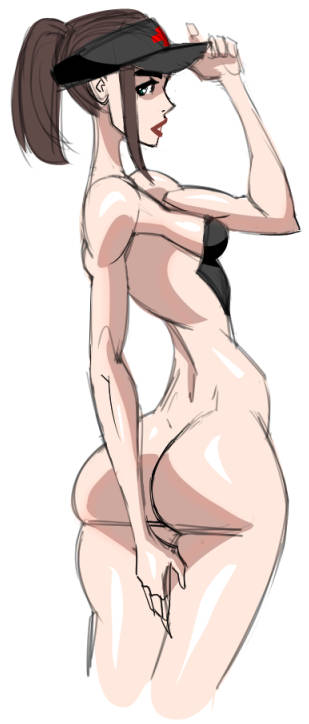J’ai raté, à cause de mes vacances, le début de cet événement annuel que j’ai découvert il y a déjà six ans, la Banned Books Week – la semaine du livre interdit (ou plutôt retiré) – organisée par une multitude d’acteurs américains autour du livre comme, entre autres, l’Association des libraires américains (ABA), l’Association des librairies américaines (ALA) et l’Association des éditeurs américains (AAP). Mais cela ne m’empêchera de vous relancer et de vous inciter à vous rendre sur le site consacré à l’événement qui offre une multitude de pistes autour des questions de la censure et de la liberté d’expression. Et qui permet de faire de belles découvertes !

L’idée à l’origine de l’événement est de donner une meilleure visibilité à des textes ayant été remis en cause, principalement dans les écoles et les librairies américaines, pour des raisons comme : violence, sexualité explicite, homosexualité, et j’en passe. Les organisateurs ont dressé la liste des titres concernés et publié les top 10 sur le site bannedbooksweek.org. On se rend compte, en l’étudiant, que les raisons invoquées pour demander le retrait d’un titres des étagères ou des listes de lecture sont souvent les mêmes : personnages LGBT, personnages transgenres, sexualité explicite.
Quand je dis « remis en cause », il faut peut-être m’expliquer : Les écoles américaines disposant de très grandes libertés dans la composition de leurs curricula, c’est l’école qui propose à ses élèves des listes de lectures. Ces listes sont évidemment soumises aux parents d’élèves et certains y trouvent à redire, très souvent pour les raisons sus-mentionnées, demandant ensuite de retirer un texte de la liste en question, privant ainsi les enfants de profiter des idées et des réflexions abordées dans le texte. Et remettant en cause, par la même occasion, les principes pédagogiques ayant présidé à la sélection. Et certains ne se gênent pas de demander à des libraires de retirer, toujours pour les mêmes raisons, certains titres de leurs étagères. Ce qui étonne moins quand on se souvient du tollé soulevé par Outrage, dernier roman de Maryssa Rachel.
On est tous plus ou moins au courant de la poussée conservatrice à l’œuvre outre-Atlantique et de l’importance qu’on y attribue aux questions de religion, et on ne saurait s’étonner d’un phénomène qui, en plein roll-back conservateur au début des années 80, a conduit les acteurs du marché du livre à aborder la question des textes bannis (retirés, interdits, etc.) et de créer la Banned Books Week. Mais qu’on ne vienne pas montrer du doigt les puritains américains aussi retardés que réactionnaires ! Il suffit d’avoir vu défiler la Manif pour tous avec ses slogans plus ou moins ouvertement homophobes et hostiles à la théorie du genre et à l’éducation sexuelle pour se convaincre que la France n’est pas encore assez vaccinée (coup de chapeau à Mme Buzyn) pour résister aux coups bas contre la liberté d’expression (et celle de réception) qui risque elle-même d’être – remise en question.
Célébrons donc, avec nos amis américains, la Banned Books Week, et profitons de cet événement pour rendre honneur aux textes qui, en dérangeant et en heurtant les sensibilités, sauvegardent l’essentiel de ce qui fait la littérature.
Les textes cités sur bannedbooksweek.org ont sans doute tous leurs mérites, mais qu’il me soit quand même permis d’en indiquer un qui me paraît digne du plus grand intérêt. Je parle de This one summer, une bande dessinée signée Mariko et Jillian Tamaki, scénariste et dessinatrice canadiennes de renommée internationale. La BD a été publiée en France en 2014, l’année même de sa parution aux États-Unis, sous le titre Cet été-là, et a reçu de nombreuses distinctions depuis sa publication. C’est dire que la renommée et la qualité ne donnent aucune garantie face à des considérations de morale religieuse.