
Malgré la taille réduite de ce livre avec à peine une centaine de pages, la multitude des voix qui résonnent dans L’emprise des femmes, dernier livre d’Anne Bert sorti le 23 novembre 2012 aux Éditions Tabou, est déconcertante : celle de la journaliste qui recueille les témoignages d’une vie peu ordinaire passée entre une volonté de soumission voire d’auto-destruction et les étages les plus élevés du pouvoir ; celle d’un ancien homme politique arrivé en fin de parcours, en proie au souvenir et à l’obsession de se révéler en se racontant ; celles, enfin, de ses maîtresses, obnubilées par une vie à l’ombre, dans les back-streets (p. 32), tiraillées entre les plaisirs des fugues et les terreurs des découvertes qu’il leur reste à faire.
Il n’est pas toujours facile de se retrouver dans le concert de toutes ces voix qui s’entremêlent, s’entre-racontent, se justifient, s’accusent, jouent avec les potentiels, dévoilant au passage des perspectives sur un passé douloureux et les plaies mal cicatrisées au fond des paroles que ces mêmes voix transportent jusqu’à nos oreilles. Au départ, une femme en train d’écouter un enregistrement. Celui d’un homme vieilli dans les couloirs du pouvoir, aux amours multiples et jamais faciles, vécues en cachette. Mais comme la vie n’est jamais aussi banale qu’on l’imagine, d’autres voix viennent se mêler au récit, et les certitudes s’envolent devant la brise qui souffle dans les récits des maîtresses. Parce que le pouvoir n’est pas toujours là où l’on pense, et la tâche de conserver son autonomie peut se révéler rude. Et ce n’est pas pour rien que l’ombre d’Abélard traîne entre les lignes des récits et au bout des ruelles. Comment, alors, être surpris par la primauté donnée aux évocations de la mort tandis que la vie, dont on pourrait pourtant croire que c’est elle que célèbre la sexualité débridée que vivent les personnages de Mme Bert, y est curieusement stérile ? Entre l’avortement que subit, avec vue sur la rade de Marseille, la première maîtresse, la mort de l’amant de celle-ci, le dépucelage tardif et la fuite au cloître d’une autre, il ne reste pas beaucoup d’espace pour les enfants, malgré ceux, déjà grands, de la première maîtresse dont on apprend l’existence au passage, tels les vestiges d’une vie depuis longtemps oubliée et rangée dans l’enfer des souvenirs périmés.
Mais la présence des nombreuses allusions à Abélard, le théologien tristement célèbre par le sort qu’il a souffert aux mains des envoyés de l’oncle Fulbert, ne sert pas uniquement à illustrer la stérilité. Ce serait se méprendre sur la profondeur des intentions de l’auteur de Perle qui nous lance un sacré écheveau, où s’emmêlent les voix des personnages et les jeux de significations plus souterraines.
Si le monde a conservé le souvenir de l’existence du châtré de la rue Chanoinesse, c’est sans doute moins à cause des ses œuvres théologiques ou philosophiques, mais à cause de son amour malheureux pour Héloïse, amour qui a survécu à – certains diraient : s’est épanoui grâce à – la séparation forcée, malgré l’espace hérissé par les murs des couvents et des monastères. De même, s’établit un lien ambivalent entre la femme auteur, qui reçoit les confiances gravées sur CD, et l’homme qui les enregistre, loin d’elle, au cœur de cette vieille capitale où il a tissé, sa vie durant, son réseau d’influences. Un lien qui les attire l’un vers l’autre et qui les réunit pour un dernier amour. Un lien établi par – la parole :
Vous revenez pour me nourrir, vous avez ce pouvoir-là de me séduire, de susciter mon désir de vous avec vos horreurs, vous comprenez me tenir avec vos mots, à défaut de votre sexe. (p. 11)
Il n’y a pas plus fort que la parole pour créer l’attraction entre deux êtres humains, peu importe le médium dont elle se sert. La présence physique peut tout au plus sceller l’acte rendu possible – nécessaire – par les échanges de paroles qui le précèdent.
L’histoire de l’auteur restée sans nom et de l’homme désigné par Dominique Alliennes, c’est donc, d’un côté, celle de la fascination exercée par les charmes de la parole. Tout comme c’est aussi celle de l’ambivalence des rapports de pouvoir au sein d’un couple où le (ou la) plus faible n’est pas toujours celui qu’on croit. Et c’est finalement celle des vies qui chancellent entre l’amour et la mort, dans une ambivalence où l’amour couleur de sang prend la place de Charon et offre un passage au vieux Silène fatigué :
… car je vous aime tant que je veux être à coup sûr votre dernière fois. (p. 115)
Une fois de plus, Anne Bert a fabriqué une de ses petites merveilles dont elle a le secret, patiemment travaillée au burin d’un style qu’elle sait manier comme d’autres le stylet, pétrie d’une culture peu commune qui permet de faire des découvertes à chaque bout de phrase. Et il suffit de se taire, de tendre la main à ses paroles, pour être emporté dans un de ses voyages dont on ne sait pas forcément où ils nous emmènent, mais qui nous laisseront à coup sûr plus riches.
Un dernier mot avant de conclure : J’ai rarement vu une couverture qui desservait à un tel point le livre qu’elle est pourtant censée mettre en valeur. Je veux bien que tout le monde essaie de sauter sur un train au 50 nuances de gris, mais quand on tient une merveille entre les mains, on ne cède pas à la facilité.
Anne Bert
L’emprise des femmes
Éditions Tabou
ISBN : 9782363260246


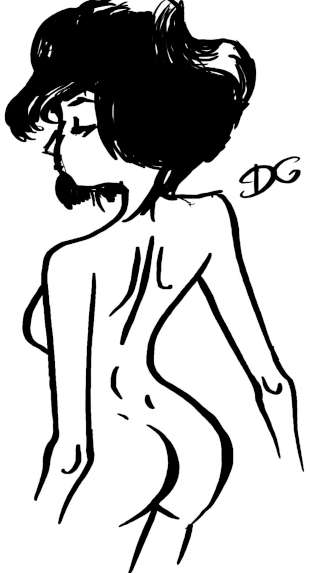
Commentaires
3 réponses à “Anne Bert, L’emprise des femmes. Un écheveau vocal”