Parlons de Liège, cette ville revêche, qu’il faut savoir découvrir pour l’aimer et dont les beautés s’apprécient au bout des efforts.

Au voyageur qui s’approche de Liège, la ville offre de partout le même spectacle : blottie au fond de sa cuve, la masse de ses toits forme une sorte de bouillie d’où s’élancent ses nombreuses églises romanes, telles des récifs pointant au milieu des flots. En même temps, ce spectacle ne laisse pas subsister le moindre doute quant aux origines de la ville : elle s’est construite autour d’un oratoire, bâti au VIème siècle, en pleine nuit mérovingienne, sur ordre de l’évêque de Tongres. Plus tard, ce furent encore et toujours des hommes d’église dont le souvenir et les actions contribuèrent à son développement rapide, principalement Saint Lambert par son martyre, Saint Hubert par le transfert du siège épiscopal et Notger, premier prince-évêque, par sa sagesse et ses bonnes relations, notamment avec l’Impératrice du Saint-Empire, Théophano.

Arrêtons-nous un peu avant de continuer la route qui nous mènera tout droit vers le carnassier bourguignon. Un homme d’origine allemande, Notger ; une femme d’origine grecque, Théophano (enterrée à Cologne, d’ailleurs), impératrice, nièce de l’Empereur de Byzance ; et une ville qui doit ses origines à l’évêque de Tongres – quel bel ensemble pour illustrer l’univers cosmopolite que fut l’ancien Empire.
Je disais donc : Bourgogne. Et effectivement, l’année 1474 fut noire pour Liège, quand, le 3 novembre, les troupes de Charles le Téméraire incendièrent et pillèrent la ville dont il ne subsista pratiquement plus rien – sauf, évidemment, ses églises.
Le souvenir de la renaissance de Liège est lié à un homme dont les origines sont – encore une fois – germaniques : Érard de La Marck, issu d’une famille illustre qui a donné des archevêques à Cologne, des prince-évêques à Liège et qui a fait construire le château-fort de Sedan. Tandis qu’un de ses ancêtres, Guillaume, le mal-famé « Sanglier des Ardennes », préférait encore contribuer aux troubles de la cité en assassinant le prince-évêque, Érard choisit de la reconstruire. Notamment son palais dont on a même dit qu’il était plus « accomply que n’est le Louvre et que ne sont les Tuileries à Paris » (ce fut, bien-sûr, avant l’époque du grand Louis).

Les siècles suivants voient la ville et sa principauté fleurir économiquement, profitant de sa situation privilégié au carrefour des routes de France, d’Allemagne et de Hollande.
L’Histoire des Princes-évêques se termine avec l’arrivée des troupes françaises, en 1792 et, après l’intermède d’une brève restauration autrichienne, en 1794. Mais le signe le plus retentissant du grand changement qui était en train de s’opérer en cette fin de siècle fut la tenue d’un référendum sur le rattachement à la France, entérinant la décision de quitter le Saint-Empire. Le signal le plus visible, le plus spectaculaire et le plus durable fut donné, à partir de la même année, par la décision de démolir la cathédrale Saint-Lambert qui, aux yeux des insurgés, symbolisait la tyrannie et la féodalité.
Pendant des siècles, Liège a défendu son indépendance, concédée en 980 par l’Empereur Otton II, au sein de l’Empire. Et le prix à payer fut parfois exorbitant, surtout au XVe siècle qui a failli voir la fin de la ville. C’est au souvenir des événements de ces années sombres que Liège doit son titre de « Cité ardente », la ville qui brûle, même si, aujourd’hui, celui-ci évoque plutôt, passé minier oblige, les hauts fourneaux où ont été forgées les richesses du XIXe siècle ainsi que les armes des guerres du XXe.
Le présent s’annonce plus paisible, malgré les conflits entre les groupes linguistiques qui composent la Belgique. La vocation de Liège est, nous l’avons vu, internationale et universelle. Et comment s’attendre à autre chose de la part d’une ville qui fut fondée au carrefour des civilisations. Que le pays auquel elle appartient s’appelle Belgique, Wallonie ou, un beau jour, Europe, cela n’y changera rien. C’est bien dans ce sens-là que l’indépendance n’a jamais été perdue.

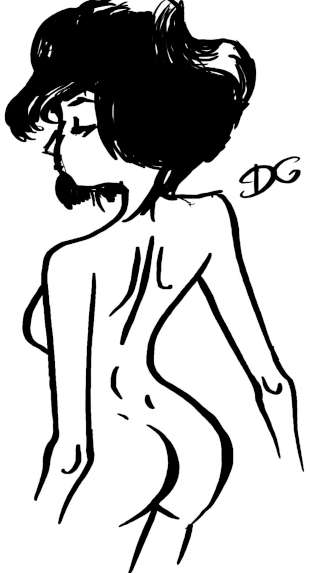
Commentaires
Une réponse à “Liège ou l’indépendance ardemment défendue”