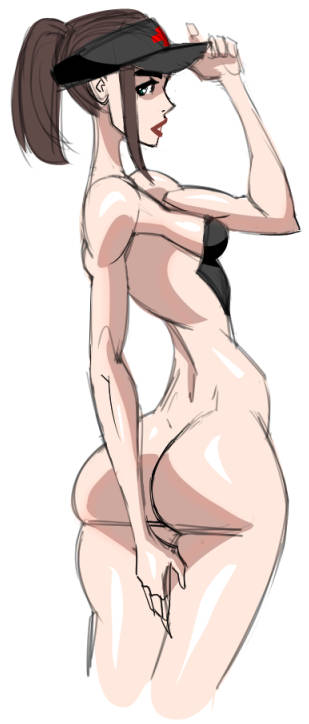Dans son dernier roman, Le blanc va aux sorcières, publié le 1 septembre 2011 par Galaade Éditions , la jeune auteure britannique Helen Oyeyemi met en scène une des grandes constantes qui régissent la littérature depuis ses origines les plus lointaines, à savoir la migration.
C’est l’histoire de plusieurs générations de femmes, atteintes par une maladie héréditaire, et dont le sort est une mort – ou mieux : une disparition – précoce. C’est l’histoire aussi d’une maison appelée à vivre d’une vie autonome par la Grand Anna, première dans cette lignée funeste, par une nuit de feu, de flammes et de mort. C’est l’histoire, ensuite, de fuites, amorcées ou avortées : Celle de Jenny qui n’a même pas réussi à sortir de la maison avant de s’y perdre, celle de Lily qui est morte assassinée en Haïti, celle de Miranda enfin, sa fille, dernier rejeton de cette famille funeste, qui disparaît après une dispute avec son frère et dont on apprend dès les premières pages qu’elle repose sous la maison, avec un quartier de pomme dans la bouche, telle une Blanche-Neige moderne avec le noir de ses robes et le rouge indélébile de ces lèvres, noire comme l’ébène et rouge comme des gouttes de sang dans la neige.

La partie la plus importante de l’histoire se passe sur la côte de la Manche, à Douvres,
- ville dont les origines se perdent dans la brume qui recouvre les époques où des peuplades migratoires prirent possession du continent qui s’étend entre la Baltique, la Mer du Nord, l’Atlantique et la Méditerranée.
- qui monte la garde sur les célèbres falaises, symbole, avec son rempart érigé par des géants, de la « splendide isolation » et de la Résistance farouche qu’opposent les Anglais aux conquérants de tous poils. Dans le livre, ce sont les épisodes de la Guerre contre l’Allemagne nazie, les bombes qui sont tombées sur Douvres en 1940, et les vestiges des abris qui rappellent et illustrent cet aspect.
- où guette, au 29 Barton Road, une présence bien ancrée dans l’espace avec son adresse postale, mais qui vient trouver les personnages jusque dans leurs refuges et les rappelle dans le giron de ses quatre murs qui abritent un espace qu’ils ne délimitent pourtant pas.
- qui garde donc l’entrée de la Grande-Bretagne et où se trouve un centre de rétention des immigrés clandestins dont l’ambiance morne et suicidaire envahit la ville avoisinante, avec ses Kosovars qu’on assassine, et les bandes de filles qui traînent dans les rues.
Ces immigrés, ils sont au cœur même du roman, qu’ils viennent de l’autre côté de la Manche, comme Luc, le père de Miranda et d’Eliot, son frère jumeau, ou qu’ils viennent carrément d’un autre continent, comme la belle Africaine, Ore, une des voix par qui se tisse le récit. Les immigrés pénètrent jusque dans la maison, où ils travaillent dans des fonctions domestiques, comme jardinier et comme gouvernante, les Kosovars Ezma et Azwer d’abord, Sade ensuite, l’incarnation presque parfaite, avec ses vêtements et ses cicatrices rituelles, de l’immigré exotique, parti du fin fond du continent noir.
Et la seule présence de ces immigrés engendre la haine et le rejet, invoqués par la Grand-Anna, suite à la mort de son mari aux mains des Allemands, pendant que leurs avions tapissent la ville de bombes, incarnés désormais par cette maison qui abrite, sublime ironie, des chambres d’hôte :
« “Ils l’ont tué”, pleura-t-elle. Je ne pouvais réagir. Sa peur du pica, des chuchotements, et sa peur des éclats de mortier et de l’incendie et oui, sa peur de moi, d’être abandonnée toute seule dans une grande maison silencieuse. Sa peur était sortie du blanc de ses yeux pour s’infiltrer dans ma brique jusqu’à ce que je devienne forte, jusqu’à ce que je prenne conscience.
[…]
- Je les déteste, dit-elle [i.e. Anna]. Les noirauds, les Allemands, les tueurs, sales … sales tueurs. » (p. 164)
Mais les immigrés, ce ne sont pas que des êtres humains avec leur histoire, leurs besoins et leurs misères, ce sont aussi des récits, des mythes, et des légendes qui se transmettent, de bouche à oreille, murmurés au fond des nuits noires, près d’un feu ou dans une chambre d’étudiant, et qui s’incarnent au bon milieu de notre modernité, transportés des quatre coins du globe.
La maison hantée, vivante, rappelle bien évidemment celle de la célèbre famille Usher, celle qui pourrit au fond d’un lugubre étang, quelque part dans une forêt vierge de la Nouvelle Angleterre et où ont sombré avec elle, déjà, un frère et sa sœur. La maison de Barton Road, après avoir été engloutie par la haine, renferme des morts-vivants, des femmes disparues qui continuent leur existence dans une sorte d’entre-deux, dans lequel Miranda les rejoindra à la fin de l’histoire. Avec elles, en elles, il y a une autre présence, bien plus inquiétante encore, la soucouyant, sorte de vampire des Caraïbes, née de la rencontre de traditions franco-européennes et africaines, vieille femme qui sort, la nuit, de sa peau, pour venir sucer le sang des vivants qui s’amoindrissent jusqu’au point de disparaître. Comme Miranda, jeune fille anorexique, comme Ore qui retournera bien changée à la maison de ses parents (« Est-ce que tu as laissé une moitié de toi à Cambridge ? » lui demande sa mère quand elle rentre à la maison), et qui sentira quelque chose la quitter, quand elle rendra visite à Miranda, en couchant avec elle : « Tandis que nous nous embrassions, je pris conscience que quelque chose me quittait. […] Cela me quitta par une douleur sur le flanc et passa en Miranda. » (p. 287)
Miranda la victime, aspirée par un être venu d’au-delà de la tombe, se confond avec l’agresseur, la proie se fait assassin, le fantastique se greffe sur le corps bien réel d’une adolescente jusqu’à la couvrir d’une sorte d’écorce humaine, au point que les photos ne lui ressemblent plus et que les gens la prennent pour une autre. Le récit de cette transformation, d’abord, et de cette disparition, ensuite, est troublant, et la peine du lecteur qui se fraye un chemin à travers les voix discordantes des narrateurs est amplement rémunérée. Mais l’important n’est pas là, dans le destin d’une adolescente dont le « coming of age » mène à la disparition, aussi passionnant soit-il. L’intérêt principal ne réside pas non plus dans la maison hantée, héritière de toute une tradition, malgré l’art de l’auteure de créer une ambiance bien particulière entre ses murs tordus. Ce qui fascine, c’est la rencontre des récits migratoires, qui engendre une progéniture fertile, et qui appelle à l’existence une figure vampirique qui non seulement hante une maison rendue vivante par le rejet de l’autre, qui non seulement tue à feu doux la Blanche-Neige que ne sauvera aucun Prince Charmant, en se parant des attraits d’une contrée cauchemardesque, mais qui, surtout, se glisse sournoisement dans nos idées, où la boule de feu de la soucouyant à la recherche de sa dépouille, passera éternellement dans le ciel tendu au-dessus d’une mer grise à l’aube, et dont les vagues, en clapotant, nous apportent les récits des bouts du monde. Tous les récits.
Une dernière remarque : Pendant la lecture, j’ai parfois eu l’impression de patauger dans une couche gluante qui m’empêchait de pénétrer plus avant dans la perception du texte. Après avoir pu lire quelques passages dans la langue originale, je pense que cet effet est dû à la traduction qui recouvre trop de détails et trop de précisions d’une approximation inhérente à tout essai de remplacer l’original par l’imitation dans une autre langue. Je recommande donc aux amateurs de se procurer l’original, paru sous le titre : White is for witching chez l’éditeur britannique Picador.
Helen Oyeyemi
Le blanc va aux sorcières
(White is for witching)
Galaade Éditions
ISBN : 9782351764350