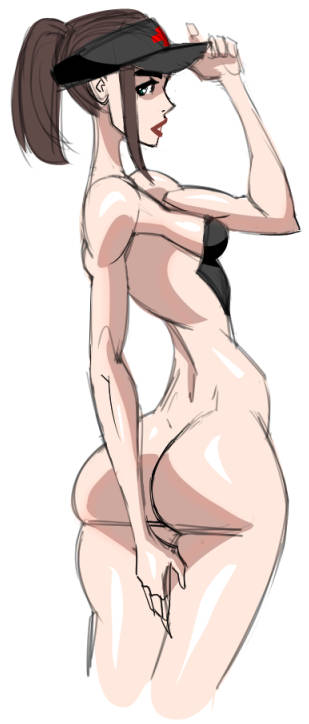« son [i.e. celui de Mariette Lydis] talent est trop universellement connu et apprécié pour qu’il soit nécessaire de présenter cette artiste à nos lecteurs.« 1
Il y a pourtant, malgré une chute notable de sa notoriété auprès du public, de fortes chances que, en tant que lectrice ou lecteur francophone, vous ayez déjà entendu parler de cette artiste qui, issue de la bourgeoisie aisée de la société austro-hongroise, a passé une vie cosmopolite un peu partout en Europe et le monde. Ce parcours comprend une multitude de voyages ainsi que des séjours prolongés en Grèce et en Italie, mais surtout deux longues étapes en France, une première fois entre 1926 et 1939, terminée par une fuite devant la marée fasciste d’abord en Angleterre et ensuite en Argentine, et une seconde entre 1948 et le début des années cinquante quand elle s’embarqua une nouvelle fois – définitive, cette fois-ci – pour l’Argentine où elle allait consacrer de longues années à une carrière d’artiste extraordinaire, carrière qui s’est finalement terminée en 1970.
Pendant ses années françaises, Mariette Lydis s’est taillé une solide réputation d’artiste d’avant-garde2 en illustrant des textes d’auteurs aussi cotés que par exemple Pierre Louÿs, Charles Baudelaire, Octave Mirbeau, Paul Valéry, Paul Verlaine et Jules Supervielle. C’est à travers cette activité-là que Mariette Lydis a laissé de nombreuses traces et qu’il est possible de retrouver ses œuvres sur les sites des antiquaires, parfois à des prix abordables. C’est ainsi que je suis entré en possession d’une de ses eaux-fortes, une illustration pour les poèmes de la célèbre chanteuse grecque des plaisirs de l’homosexualité au féminin, Sappho.

L’illustration met en scène deux jeunes filles dénudées, confortablement installées sur une couverture avec même à portée de main des oreillers pour un usage ultérieur quand il s’agira peut-être de relever des bassins ou de recevoir un corps en extase, le tout au milieu d’un paysage sobre qui n’a rien de très spécifique ni de très séduisant. L’attention de celle ou de celui qui regarde la scène est ainsi entièrement focalisée sur la jeune fille au milieu de la composition, celle que son regard franc et sa position légèrement élevée par rapport à sa partenaire désignent comme la partie dominante dans ce jeu de séduction. Un rôle que la belle remplit avec toute la dextérité d’une séductrice expérimentée, même si elle – ou plutôt l’artiste – cache bien son jeu. Car pour comprendre ce qui se passe à l’abri des yeux – ou presque – il faut essayer de suivre le bras gauche de la demoiselle du milieu, un membre en grande partie caché par les jambes de sa camarade qui donne toutes les apparences de celle qui se laisse faire, les yeux mi-clos – en signe de soumission, pour mieux apprécier les caresses ou pour mieux jouer à l’innocente ? Peu importe, les choix sont faits et les dés sont jetés, parce que l’attention aux détails finit par révéler que la main de la séductrice conquérante est déjà posée sur l’entrejambe, et le spectateur averti n’aura pas trop de mal à imaginer les délicieuses caresses que la femme prodigue à sa victime mise sous le charme par le regard qui inexorablement la fixe, mieux sans doute que des entraves.
À voir défiler un aperçu des illustrations que Mariette Lydis a contribuées à des œuvres aussi diverses que les romans de Pierre Louÿs, la Beggar’s Opera ou donc les poèmes de Sappho – comme par exemple sur le site d’Abebooks ou encore sur Google Images – on se rend vite compte de ce que celles-ci dégagent quelque chose de très personnel, quelque chose qui non seulement les fait remarquer, mais qui leur confie une sorte d’authenticité, presque comme une signature à part entière.
Jeu des oppositions et des correspondances
L’eau-forte que je viens d’acquérir n’est qu’un infime échantillon d’une activité artistique couvrant des décennies et des aires géographiques très diverses, aux inspirations et aux influences aussi multiples que ses lectures ou les gens qu’elle fréquentait. Mais, malgré la diversité des sujets et des techniques, il me semble qu’on peut trouver ici des éléments qui reviennent de façon systématique, comme l’opposition entre, d’un côté, les lignes très nettes utilisées pour dessiner les silhouettes, presque des frontières pour délimiter dans la composition l’espace qui revient aux individus, tandis que de l’autre s’épand le flou des ombres rendues par un usage extrêmement léger et presque réticent des outils à sa disposition, ce qui produit l’effet ouateux, proche de l’aquarelle, pour conférer aux horizons une profondeur où tout menace de s’estomper, malgré la persistance des lignes nettes qui, dans le dessin pour Sappho, dessinent la montagne qui se dresse à l’horizon comme pour clôturer les espaces sensuelles, pour leur donner un cadre, une réminiscence sans doute des jardins clos d’antan.
L’opposition entre la ligne nette des corps et le flou des ombres et des feuillages se reflète d’ailleurs dans celle entre l’écorce rugueuse du tronc d’arbre et le velouté des peaux de jeunes filles ou encore la douceur des coussins et de la couverture que les deux nymphes ont choisi pour lit de repos en pleine nature ou encore le plumage des oiseaux dont le vol semble souligner et en même temps prolonger le massif rocheux au loin. Opposition qui semble d’ailleurs appeler voire provoquer des correspondances, que ce soit entre les corps des jeunes filles qui semblent sorties d’un même moule, entre les chevelures qui partagent le même noir scintillant, les regards qui se croisent (à moins de se confronter) ou encore les branches qui reprennent et portent au loin la figure que dessinent les corps dénudés, cette lettre X formée par des corps qui se croisent et qui rappelle l’écart des cuisses qui ne tarderont pas à s’ouvrir pour admettre la délicieuse intruse.
« Cité des femmes » – Vienne sous influence

Si j’ai découvert Mariette Lydis, c’est grâce au compte-rendu par la Süddeutsche Zeitung d’une exposition qui se tient, depuis le 25 janvier 2019, au Belvedere de Vienne, Cité des femmes. L’intention de cette exposition est de faire (re-)découvrir le rôle éminent des artistes féminins dans l’Autriche de la première moitié du XXe siècle, de montrer à quel point celles-ci ont été un ingrédient indispensable de cette société bouillonnante qui a vu tant d’artistes s’épanouir. Et parmi eux donc un grand nombre de femmes ayant réussi à s’imposer comme incontournables malgré toutes les résistances et tous les obstacles, et malgré surtout la condescendance d’une bonne partie de la gent masculine dont certains représentants continuaient – à l’orée du XXe siècle – à se demander si les femmes avaient une âme ou si elles étaient seulement douées de facultés créatives. Face à de telles attitudes, on comprend à quel point la lutte a été dure pour se faire reconnaître, à une époque qui d’un côté s’enfiévrait de sa modernité et adulait l’idée du progrès comme peu d’autres tandis que, de l’autre, les sociétés d’artistes et les académies refusaient tout bêtement d’accepter des femmes comme membres ou comme étudiantes. Quant à mes congénères d’il y a plus ou moins un siècle, je reste bouche-bée devant un manque aussi flagrant de courage et de savoir-vivre, manque qui va de pair avec une évidente absence de couilles, parce qu’on peut quand même se demander si c’est plutôt la bêtise ou bien la peur qui nourrissent une telle attitude. La peur de se voir remis à sa place face à un réservoir de talents aussi immense que celui que Sabine Fellner, commissaire de l’exposition, nous fait découvrir à travers les 260 objets exposés et un défilé impressionnant de femmes-artistes finalement donc sorties de l’obscurité où les ont plongées les années noires du fascisme et l’embourgeoisement des années d’après-guerre. L’équipe rassemblée par Mme Fellner montre avec une belle verve et à grand renfort de chefs d’œuvre parfois spectaculaires à quel point de telles attitudes étaient (et le sont) mal placées face à une force créative que même la brutalité et l’ignorance des nazis n’ont pu réussir à anéantir. Des vies ont été brisées et des carrières avortées, mais une grande partie des œuvres – des tableaux, des dessins, des sculptures – a survécu à la barbarie et au feu des bombes pour nous rendre un époustouflant témoignage de la part qui revient aux femmes dans la genèse de ce que l’on aime appeler l’art moderne.
Teresa Feodorowna Ries – une carrière brisée

Un exemple impressionnant pour ce qu’il convient d’appeler l’odyssée des œuvres est fourni par une sculpture de Teresa Feodorowna Ries, Sorcière à sa Toilette avant la Nuit de Walpurgis. Cette sculpture exécutée en 1895 – par une jeune femme de 22 ans ! – causa un scandale quand elle fut exposée quelques mois plus tard, en 1896, à l’exposition de printemps de la Maison des Artistes (« Künstlerhaus »), où le journaliste Emmerich Ranzoni l’apostropha dès qu’il l’aperçut en lui reprochant d’avoir tiré une grimace horripilante du noble marbre et en proposant de lui interdire l’accès à l’exposition.3
Mais tandis que les uns, rendus aveugles par leurs idées préconçues et le refus de s’aérer les méninges, n’y voyaient que la laideur d’une vieille garce en train de se couper les griffes, d’autres, plus perspicaces, y ont perçu une dimension bien autrement plus intéressante. Il suffit de relire les impressions de Stefan Zweig, empreintes d’une sensualité si délicieusement fin de siècle, qui décèle dans la figure de la sorcière
le sourire lubrique et impatient qui rêve d’orgies diaboliques, la sensualité qui à peine se maîtrise, une ambiance lourde, irritante, sataniste, tout ça se réalise dans cette seule figure.4
L’exposition s’est d’ailleurs soldée par un très beau succès pour la créatrice de la Sorcière, l’Empereur lui même ayant daigné s’enquérir du nom de l’artiste avec laquelle il a ensuite passé une demi-heure à discuter et à lui poser des questions.5
Un scandale presque immédiatement suivi par une justification partie des plus hautes sphères, voici les ingrédients pour se tailler une réputation, une recette qui n’a pas changé depuis. C’était donc bien parti pour la carrière de Teresa Ries, et ni la reconnaissance ni les commandes ne se firent attendre. Il existe même une photo qui la montre, à peine deux ans après ses débuts fulgurants à Vienne, en train de réaliser une sculpture de l’écrivain Mark Twain, l’écrivain sagement assis sur un tabouret pour lui servir de modèle6. Pendant quelques décennies, cette artiste pouvait donc réaliser ses rêves, mais la vague brune n’allait pas l’épargner, et, d’origine juive, femme-artiste, elle fut une cible de choix pour les brutes qui s’étaient emparées de l’Autriche en 1938, et elle dut s’exiler pour fuir le régime fasciste et la menace que celui-ci faisait peser sur sa vie. Ensuite, un grand nombre de ses œuvres a été détruit ou perdu, une absence physique comme une plaie supplémentaire dans le tissu de l’Europe civilisée. Mais comme le hasard fait parfois bien les choses, la Sorcière a échappé à ce sort-là et a survécu au fléau, mutilée mais riche d’un passé extraordinaire. C’est d’ailleurs justement le bras tenant les ciseaux qui a disparu, on remercie donc les photographes qui ont immortalisé notre Sorcière dans son état original.
Un sort parmi tant d’autres que celui de Teresa Feodorowna Ries qui a failli être effacée de la mémoire collective, et ce malgré une réputation solidement ancrée. Quid de tant d’autres dont la renommée aurait encore pu se faire ? Face au noir de l’oubli, il faut donc d’autant plus remercier le travail assidu de femmes telles que Sabine Fellner ou Andrea Winklbauer qui se donnent toutes les peines pour faire revivre le souvenir de ces mondes qui auraient – sans elles – disparu pour de bon. Quant à la Sorcière, si je n’ai pas encore pu trouver le récit de son périple, elle fait le tour des expositions depuis des années déjà7, focalisant l’attention des visiteurs et des journalistes, ambassadrice d’une artiste et de sa maîtrise de la matière.

Avis aux amateurs d’art soucieux de sortir des sentiers trop courus : Cité des femmes restera ouverte jusqu’au 19 mai 2019. Et si jamais – comme moi – vous avez raté l’occasion pour cause d’agenda bourré, il y a toujours le catalogue bilingue allemand / anglais.
- Notice parue dans l’édition du 7 juin 1935 de l’hebdomadaire L’Européen. ↩︎
- Une « up-and-coming avant-garde artist », pour citer l’article qui lui est consacré dans la Wikipedia anglophone ↩︎
- Teresa Ries raconte la scène dans son autobiographie, Le langage de la Pierre, paru en 1928 et cité ici d’après Andrea Winklbauer et son article Eine Hexe sur le site du Musée juif de Vienne. ↩︎
- « das lüstern-erwartungvolle Lächeln, das von den teuflischen Orgien träumt, die Sinnlichkeit, die sich kaum zurückhalten läßt, eine schwüle, verwirrende, satanistische Stimmung verwirklicht sich alles in dieser einen Gestalt. », Stefan Zweig : Kurze Texte über Musiker und bildende Künstler, chapitre 7 ↩︎
- Pour ce qui s’est passé sur l’exposition, cf. Julie M. Johnson, The Memory Factory : The Forgotten Women Artists of Vienna 1900, Purdue University Press, 2012, pp. 209 – 211 ↩︎
- Cf. l’article sus-mentionné, Eine Hexe ↩︎
- Je l’ai retrouvée en 2008 à Linz dans l’expo Trouble-fête – les horreurs de l’Avant-garde de Makart à Nitsch ; en 2009 à Speyer dans l’expo Sorcières – mythe et réalité (p. 28 du document) ; et à Vienne encore, en 2016, au Musée juif pour l’expo La meilleure moitié, consacrée aux femmes-artistes ↩︎