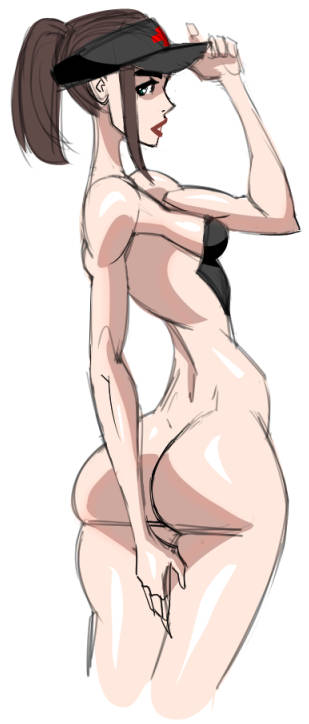Vincent Almendros est un jeune auteur dont on a pu dire, à l’occasion de la sortie de son deuxième texte, Un été, que dans ses romans « chantait le clapotis de la mer« 1. Dans un texte qui parle d’une sorte de randonnée maritime en voilier de plaisance, ce clapotis fait bien entendu partie des accessoires incontournables, le tout est de savoir comment l’auteur s’y prend pour créer une telle intensité des perceptions dans son texte et comment il en profite pour faire contrepoids à l’intensité des sentiments qui cuvent dans un espace aussi restreint que la coque d’un navire où quatre personnages essaient de bouger sur un terrain rendu dangereux non seulement par l’absence de terre ferme, mais surtout par les failles que leurs antécédents y ont creusées.
Quelques mots suffisent pour résumer l’intrigue de ce petit texte – novella voire nouvelle plutôt que roman : Deux couples s’embarquent pour un périple au départ de Naples, deux anciens amants se retrouvent, le temps de quelques remarques bien ciblées, de quelques regards appuyés et d’une partie de jambes en l’air, un couple se défait, le tout entrecoupé de balades dans des petites villes italiennes enfilées sur le littoral de la Mer Tyrrhénienne. On y fait des courses, on se baigne, on pêche, rien de bien extraordinaire. L’intrigue, ainsi détricotée, paraît – banale. Mais ce n’est de toute façon pas l’intrigue qui fait sortir du rang cette petite centaine de pages. Par contre, il y plane, et dès les premiers chapitres, comme une odeur iodée à laquelle l’on ne saurait échapper, le lecteur étant aussitôt emporté par un véritable assaut des sens livré par l’eau de mer, par les silhouettes des îles, les criques à l’eau claire – infestée de méduses parfois – la roche chauffée à blanc, les horizons qui se dévoilent du haut de la petite ville d’Agropoli, les gouttes de pluie qui ricochent sur les pierres des quais du bassin de port, et jusqu’à la chaleur caniculaire du port de Naples, à 9 heures du matin, qui donne le ton du récit :
[Lone] venait de s’asseoir sur des marches et s’éventait avec le plan replié de Naples. Elle me sourit, sans rien dire. Elle était fatiguée. Elle avait chaud. Les ailes de son nez étaient pailletées de gouttelettes de transpiration.
Quelques petits mots pour capturer quelques gestes, minuscules, et on imagine à quel point il est pénible de bouger dans une telle chaleur, de rejoindre le lieu du rendez-vous après s’être trompé une première fois, le béton et la pierre transformés en four par les rayons de soleil d’un mois d’août à Naples. Les détails de cet embarquement à obstacles annoncent la suite, l’ambiance surchauffée qui règne entre les couples confinés sur quelques mètres carré, une méfiance qui pourtant tarde à s’exprimer ailleurs que dans des pensées ébauchées et des regards qui ne s’arrêtent jamais de façon trop peu équivoque.
De temps en temps, l’auteur sert aux lecteurs des bouts de passé, en très petits morceaux, pour permettre à ceux-ci de comprendre qu’il y a de l’histoire entre Charles et Jeanne, liés par une relation amoureuse qui s’est terminée quand Jeanne a décidé de passer d’un frère à l’autre2. Dans quelles circonstances ? Le récit ne le révèle pas. Mais ce n’est pas important, ce n’est pas là le propos du texte qui, au lieu de plonger dans le passé, fait plonger le lecteur dans l’eau du port de Capri, à la découverte de la luminosité du plancton et de ses effets magiques dans l’eau nocturne :
« j’entendais que quelque chose crépitait sous l’eau, une sorte de grésillement sec, et bientôt des étincelles commencèrent à s’agiter devant moi. Je continuai d’avancer en regardant ces lumières qui me guidaient comme de minuscules vers luisants sous-marins, que j’essayais en vain d’attraper et qui me filaient entre les doigts en se démultipliant. »
Malgré une certaine tension sexuelle, il n’y a rien qui permette de classer ce texte d’érotique, même la partie de galipettes à laquelle Jeanne invite son ancien amant se déroulant à l’abri des regards. L’été par contre y est capturé sous toutes ses coutures, le charme de la Méditerranée se trouvant à pratiquement chaque page, et la seule évocation des noms propres montre à quel point le texte souscrit à un certain romantisme délicieusement désuet : Naples, Vésuve, Capri – un peu comme si les souvenirs du Voyage italien de Goethe, les poèmes d’une Angleterre romantique en exil et les manies d’un Stendhal étaient revenus pour hanter l’imaginaire contemporain.
Comme je l’ai précisé en début d’article, le lecteur se trouve en présence de deux couples : Pierre et Lone, et Jean et Jeanne. Comme rien n’est jamais trop peu compliqué, la relation entre les couples s’enrichit d’une dimension familiale, Pierre et Jean étant des frères. Malgré ce départ des plus classiques, il n’y a quand même que deux personnages à vraiment occuper les devants de la scène, Pierre et Jeanne, dont l’histoire ancienne rajoute une complication supplémentaire au ménage à quatre. Pierre et Jeanne ont effectivement été des amants, sans que le lecteur en sache beaucoup plus que cela, et ils se retrouvent, le temps de quelques jours en mer, le temps aussi de quelques galipettes. Les deux autres, Lone et Jean, sont à peine plus que des figurants, des personnages sans le moindre intérêt. On peut d’ailleurs se demander pourquoi l’auteur a décidé d’introduire un personnage comme Lone qui n’a à proprement dire aucun rôle à remplir – à moins que ce soit dans un souci de symétrie ou pour consacrer à une certaine tradition (comme on ne parle jamais assez de Goethe, mentionnons les Affinités électives.). En même temps, c’est précisément le traitement linguistique que le narrateur fait subir à la jeune Norvégienne, qui révèle à quel point M. Almendros sait aiguiser sa plume quand le besoin s’en fait sentir : On est au tout début du récit, on ne sait rien encore à propos des personnages et des rôles qui leur seront attribués, que déjà Lone se trouve reléguée au second plan :
« En arrivant devant l’édifice un peu après neuf heures, nous décidâmes, avec Lone, d’attendre de l’autre côté de la voie rapide. »
Et voici un nous qui exclut la seule personne qui aurait pourtant pu le justifier. Lone est tout de suite mise de côté, passagère clandestine, inopportune, et le lecteur qui bute contre cet obstacle en plein milieu de phrase se demande de quoi il en retourne.
En même temps – pour reprendre cette formule remise à l’honneur par Emmanuel Macron – Almendros use d’un humour tout en douceur en lançant un clin d’œil des plus cocasses à Phillip Noyce et son Calme blanc, film où les passions se déchaînent avec une violence autrement plus dérangeante. Ne voit-on pas Pierre mentir à son frère quand celui-ci s’apprête à descendre dans l’eau infestée de méduses ? Et Jean qui, l’espace de quelques instants, doit se poser des questions à propos des intentions homicidaires de son frère :
« Son visage s’était fermé. Il se lécha nerveusement les lèvres. Il semblait avoir du mal à respirer. Il inspirait profondément mais quelque chose l’empêchait d’aller au bout. »
En parlant de cinéma, c’est sans doute l’occasion de mentionner l’importance du jeu incessant des regards et des perspectives qu’on trouve dans le texte. Les regards qui se fuient, et les perspectives qui, à tour de rôle, se rétrécissent et s’élargissent, comme au rythme d’une respiration, tantôt se brisant contre les parois de l’embarcation chétive, tantôt s’élançant vers le large, la Méditerranée dont l’immensité s’étend sous des regards libérés.

Changement de décor radical dans le dernier chapitre, qui substitue à la Méditerranée du Mezzogiorno la beaucoup plus prosaïque Île de France. Cette fin – ou plutôt ce dénouement, puisque le lecteur n’arrête pas de chercher le mystère dans la rencontre des anciens amants, rencontre visiblement orchestrée par Jeanne – apporte des éléments de réponse aux interrogations du lecteur, mais celui-ci en sort aussi avec un sentiment de frustration. Parce que malgré la fascination qui se dégage des pages, malgré la parfaite immersion par les sens, malgré l’art qui a su tisser les liens d’un réseau compliqué, avec au milieu cette Jeanne qui en commande les fils, je suis resté bouche-bée face à la conclusion. Qui, franchement, n’est pas à la hauteur de tout ce qui l’a précédée, de cette patience si appliquée qui construit non seulement une œuvre, mais un univers minuscule qui éclot sous le regard éberlué du lecteur / spectateur. J’ai eu l’impression d’assister à une sorte d’évacuation, comme si l’auteur se voulait débarrasser de ses personnages, phénomène que je croyais réservé à des textes autrement plus ambitieux qui se déclinent en d’innombrables volumes au point de tenir l’auteur prisonnier de ses propres personnages. Mais on peut aussi se demander si le changement de décor n’y est pas pour quelque chose, dans ce retour à une certaine banalité dépourvue de charme, et si ce n’est pas justement l’ambiance méditerranéenne qui a permis à l’auteur de rédiger ce texte. Dont les élans, malgré la conclusion peu convaincante, restent un souvenir précieux.
Vincent Almendros
Un été
Les éditions de Minuit
ISBN : 9782707328137
- Marine Landrot sur Télérama. ↩︎
- Faisons remarquer au passage que Marine Landrot, dans son article sus-cité, a visiblement confondu les deux frères et les couples en question : À côté du couple « officiel » – Jean et Jeanne – il y a celui qui le précède, Pierre et Jeanne, et c’est de cette configuration quelque peu malsaine que naît la tension entre les personnages et que le texte tire une grande partie de sa dynamique. ↩︎